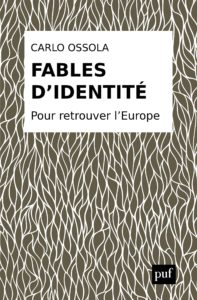 Trois cent pages, ce n’est pas trop pour évoquer « le patrimoine commun de la mémoire européenne », « un entrelaces d’histoires à interpréter », des histoires qui seraient néanmoins sous-tendues par un principe commun, le « Souverain bien ». Telle est le défi que s’est lancé Carlo Ossola. Et il ne fallait pas moins qu’un érudit comme il l’est lui-même, professeur de « Littératures modernes de l’Europe néolatine » au Collège de France, pour le relever. Disons tout de suite notre admiration pour l’immense culture de l’auteur et son habileté à nous en transmettre une part. Car, à l’heure de la crise des « humanités » (de la lecture, de l’enseignement), il est bien clair que le patrimoine dont il s’agit se trouve plutôt sur les rayons des bibliothèques que dans la mémoire vivante des Européens, lesquels n’ont que des souvenirs diffus, pour ne pas dire confus, des quelques grands mythes, des quelques grandes œuvres dont on leur a « parlé », à l’école. L’auteur de ces lignes est suffisamment âgé pour que l’un de ses grands-pères sût encore, longtemps après ses études, quelques centaines de vers latins : nous n’en sommes plus là ! Autant dire que si ce livre devrait séduire un public intellectuel et curieux du passé, il risque de tomber rapidement des mains des acheteurs attirés par la conjonction des mots « identité » et « Europe » sur la couverture.
Trois cent pages, ce n’est pas trop pour évoquer « le patrimoine commun de la mémoire européenne », « un entrelaces d’histoires à interpréter », des histoires qui seraient néanmoins sous-tendues par un principe commun, le « Souverain bien ». Telle est le défi que s’est lancé Carlo Ossola. Et il ne fallait pas moins qu’un érudit comme il l’est lui-même, professeur de « Littératures modernes de l’Europe néolatine » au Collège de France, pour le relever. Disons tout de suite notre admiration pour l’immense culture de l’auteur et son habileté à nous en transmettre une part. Car, à l’heure de la crise des « humanités » (de la lecture, de l’enseignement), il est bien clair que le patrimoine dont il s’agit se trouve plutôt sur les rayons des bibliothèques que dans la mémoire vivante des Européens, lesquels n’ont que des souvenirs diffus, pour ne pas dire confus, des quelques grands mythes, des quelques grandes œuvres dont on leur a « parlé », à l’école. L’auteur de ces lignes est suffisamment âgé pour que l’un de ses grands-pères sût encore, longtemps après ses études, quelques centaines de vers latins : nous n’en sommes plus là ! Autant dire que si ce livre devrait séduire un public intellectuel et curieux du passé, il risque de tomber rapidement des mains des acheteurs attirés par la conjonction des mots « identité » et « Europe » sur la couverture.
Aux XVIII et XIXe siècles, la pratique du « Grand Tour » était à la mode chez les jeunes hommes fortunés. Partis de Londres ou de Berlin, ils voyageaient jusqu’à Rome en faisant halte dans les hauts lieux d’une culture qui était alors véritablement la leur. Dans la première partie de son livre, C. Ossola nous invite à le suivre dans son propre Grand Tour, seize étapes d’un itinéraire tarabiscoté d’Anderlecht (Pays-Bas) à Rome, qui pousse vers l’Est jusqu’à Ankara et vers l’ouest jusqu’à Lisbonne (ou plutôt Belém). Chaque station est l’occasion d’associer aux vestiges de l’Europe d’antan une ou plusieurs grandes figures intellectuelles, de l’Antiquité au XXe siècle. Ainsi Anderlecht est l’occasion d’évoquer Erasme ; Fréjus : Sieyès, Trèves : Marx ; Belèm : Pessoa (et le Traité de Lisbonne), etc.
La deuxième partie dont la Divine Comédie constitue un fil conducteur assez lâche analyse les fondements de l’Europe tels que C. Ossola les perçoit : la quête et le devoir autour des personnages d’Ulysse et Enée ; l’amour et l’âme autour d’Éros et Psyché ; le « lieu commun » autour d’Aristote. Un dernier chapitre se penche sur le monde soviétique et sur les jugements par l’eau et par le feu tels qu’on les pratiquait au Moyen Âge, une note finale pour le moins incongrue, comme si le livre devait se conclure sur la part maudite de l’Europe (qui fait certes partie de son identité !)
C’est le précédent et pénultième chapitre qui soulève cependant le plus de questions. Abandonnant l’approche historique, l’auteur affronte directement la question de l’identité telle qu’elle se présente à lui aujourd’hui. Il commente en ces termes l’apparition du « village global » :
« Cette concentration de l’espace est allée de pair avec une disjonction du temps : en passant d’un quartier à l’autre de nos métropoles, nous changeons de siècle. D’un côté, des individus promis à de brillantes carrières, et, à une rue de là, des femmes voilées qui passent sans mot dire, des gamins sans avenir, des migrants sans nom. Le XXIe siècle des drones cohabite avec le XIe siècle des croisades (aujourd’hui dirigées en sens inverse) » (p.212-213).
Il ajoute un peu plus loin :
« L’appel à la civilisation oppose les civilisations ; elles deviennent incompatibles et il n’est pas d’une grande utilité de croire que le « progrès » (tel qu’il s’est développé en Occident aux XIXe et XXe siècles) soit un facteur d’unification » (p. 214).
Partant de ce constat du choc des civilisations, comment faire l’Europe, alors que – nous rappelle l’auteur – l’islam est déjà la religion la plus pratiquée à Bruxelles, un islam dont il n’a certes pas été question dans les « fables » qui constituent la mémoire européenne ? Rejetant les « solutions expéditives » (comme les expulsions), C. Ossola en appelle à la constitution d’un lieu commun où règnerait une tolérance très étendue :
« L’idée que je me forme de ce qui est juste ne peut servir de mesure à l’autre, car ce qui est juste doit être partagé par l’un comme par l’autre » (p. 219).
Autant dire qu’on fait litière des droits de l’homme ! Est-ce vraiment ce que souhaite l’auteur ? Sans doute pas puisqu’il compte sur la « perméabilité réciproque » des populations et des cultures pour construire la future Europe harmonieuse qui saura combiner les valeurs communautaires ancestrales (qui manquent désormais aux « modernes ») et l’émancipation de la femme (qui fait défaut, entre autres, chez nombre d’immigrés). Quels seraient alors les contours – adaptés à la réalité d’aujourd’hui – de la « politique avisée d’intégrations successives, comprenant le droit de migration » (p. 226) qui fut celle de l’Europe romaine ? Voilà ce qu’il faudrait nous dire. Citer un seul cas d’intégration réussie dans l’Italie du XXIe siècle (la petite ville de Riace en Calabre, p. 225-226) – même s’il s’avérait durable, or il est actuellement menacé – ne saurait être probant, cet exemple ne paraissant pas reproductible dans nos banlieues-ghettos.
Carlo Ossola, Fables d’identité – Pour retrouver l’Europe, Paris, PUF, 298 p. (dont 40 p. de notes et un index nominum de 12 p.), 2018, 21 €.

