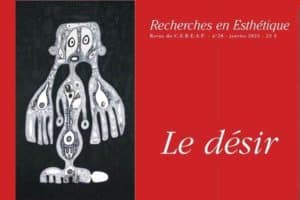 « Nous n’étions que des hommes, il ne saurait y avoir de victoire,
« Nous n’étions que des hommes, il ne saurait y avoir de victoire,
le désir, juste, jusqu’à l’engloutissement », Laurent Gaudé.
La dernière parution de la revue annuelle Recherches en Esthétique est titrée « Le désir ». Que ce dernier soit le moteur de l’artiste, nul ne le niera, mais faut-il pour autant accepter le jugement de Laurent Gaudé (qui n’est d’ailleurs pas repris dans ReE, il constitue la dernière phrase de son roman Écoutez nos défaites) ? Toute l’histoire de l’art ne témoigne-t-elle pas en effet de « victoires » ou tout au moins de succès éclatants ? Sans doute à ceci près que l’œuvre n’est plus à proprement parler l’art, c’est l’objet inanimé que l’artiste a laissé derrière lui. Elle n’est certes pas complètement morte puisqu’elle vit encore dans le regard du spectateur mais l’on n’est plus à ce moment-là dans l’art au sens premier (du latin ars, artis) qui est avant tout action. Au sens le plus général, il est en effet selon le TLF, « l’ensemble de moyens, de procédés conscients par lesquels l’homme tend à une certaine fin, cherche à atteindre un certain résultat ».
Le désir dans l’art est donc d’abord ce qui pousse à la création, en distinguant deux modalités opposées du désir et de la création, l’une joyeuse (du côté d’Éros ou de Dionysos) et l’autre sous l’influence des passions tristes : le manque, le tourment, le spleen. Cette problématique, développée dans les premières contributions du numéro, convoque la philosophie et la psychanalyse à côté de l’esthétique. Car le désir a fait en effet l’objet d’innombrables réflexions ; n’est-il pas en effet ce qui nous constitue au premier chef ? Il est présent aussi bien dans le conatus spinoziste que dans les fantasmes freudiens. Certaines de ces réflexions savantes ne ressortent d’ailleurs pas indemnes des analyses présentées dans la revue. Ainsi l’idée, chez Freud, suivant laquelle l’art serait un moyen de sublimer les pulsions sexuelles : on connaît bien des artistes célèbres qui conjuguaient – avec bonheur pour autant qu’on le sache – pratique artistique et pratique charnelle avec leurs modèles et il n’y a pas de raison de croire que la tradition s’en soit perdue, même si les peintres et les sculpteurs font moins appel de nos jours à des modèles.
On retiendra en tout cas que le désir n’a rien à voir avec le besoin. Le désir est insatiable (on retrouve Gaudé) et l’artiste authentique – pas le faiseur qui se contente de répondre aux attentes de son public – n’est par essence jamais totalement satisfait. Comme rappelle Dominique Berthet, « la création est un combat incertain duquel l’artiste ne peut s’extraire et dans lequel il s’engage totalement » (p. 63).
Tous les artistes, authentiques ou pas (sauf peut-être les pensionnaires des hôpitaux psychiatriques qui dessinent de manière obsessionnelle) sont animés par le désir de plaire, de conquérir un public ou au minimum de retenir son attention en le provoquant. Désir de plaire et de choquer pouvant d’ailleurs se rencontrer simultanément chez certains artistes : voir Picasso.
On notera le côté paradoxal de l’œuvre, à la fois signe d’une aliénation (l’incomplétude du désir) et d’une certaine liberté : « l’homme est libre quand il entre en possession de sa puissance d’agir » (Deleuze cité par Bruno Péquignot, p. 54).
On ne saurait parler du désir à propos de l’art sans évoquer celui de l’amateur. Qu’est-ce donc qui attire le visiteur d’un musée ou d’une galerie ? La curiosité, sans nul doute, la pulsion scopique (Freud encore), donc le désir de voir. S’y mêlent bien d’autres modalités du désir, à commencer par le souhait, conformiste, de se montrer « à la page ». Et plus profondément, chez les véritables amateurs-amoureux de l’art, le désir d’une forme particulière de plaisir. Christian Ruby décrit bien cette « envie d’échapper au solipsisme ou à l’ennui en se confrontant à un autre, en se disposant à se laisser absorber par cet autre dans l’enthousiasme ou la déception vis-à-vis de lui, en acceptant la transfiguration ou la dévoration (à la Joris-Karl Huysmans) comme revanches sur la mort » (p. 116).
 Contrairement au créateur, à l’artiste, l’amateur peut s’estimer comblé et il le sera d’autant plus s’il a les moyens de se procurer l’œuvre qui le ravit. Il diffère en ceci du collectionneur animé par le désir « pléonexique » d’accumuler sans cesse les objets de sa passion. Le véritable amateur confirme plutôt Hegel selon qui la contemplation d’une œuvre d’art « laisse celle-ci exister librement pour soi en tant qu’objet et s’y rapporte sans désir » (c. à d. sans désir de possession, in Esthétique, 1818-1829).
Contrairement au créateur, à l’artiste, l’amateur peut s’estimer comblé et il le sera d’autant plus s’il a les moyens de se procurer l’œuvre qui le ravit. Il diffère en ceci du collectionneur animé par le désir « pléonexique » d’accumuler sans cesse les objets de sa passion. Le véritable amateur confirme plutôt Hegel selon qui la contemplation d’une œuvre d’art « laisse celle-ci exister librement pour soi en tant qu’objet et s’y rapporte sans désir » (c. à d. sans désir de possession, in Esthétique, 1818-1829).
La deuxième partie de la revue examine des œuvres ou des artistes particuliers et d’ailleurs pas uniquement des plasticiens puisque Junia Baretto s’intéresse pour sa part à Godard et à son film Adieu au Langage (2014). Hugues Henry décortique l’œuvre de Duchamp Étant donnés : 1° La chute d’eau. 2° Le gaz d’éclairage (1946-1966), un caisson qui donne à voir à travers deux trous façon binoculaire une femme nue, tombeau de la passion inextinguible de Duchamp pour son ex-maîtresse Maria Martins. Cette installation est par ailleurs un hommage à Courbet, la statue de l’aimée n’étant visible que sous l’angle adopté par Courbet dans L’Origine du monde (1866). Lequel tableau, qui s’avère une référence incontournable dans ce numéro, a fait à lui seul l’objet d’une analyse historique et esthétique approfondie de la part de Bernard Teyssèdre (Le roman de l’Origine, 2007-1996) revisitée ici par Hélène Sirven.
On ne saurait rendre justice dans une brève recension à l’ensemble des vingt-et-une contributions du numéro (sans compter treize comptes rendus d’ouvrages). Faute de pouvoir tout citer on retiendra par exemple dans la troisième partie intitulée « Art et désir en Caraïbe », l’article de Scarlett Jesus qui passe en revue quelques artistes des Antilles françaises ayant représenté explicitement le désir, tels Ernest Breleur (série L’Énigme du désir), Michel Rovelas (série Le Minotaure), Daniel Dabriou (triptyque Origynes) ou Henri Tauliaut (l’installation Parade nuptiale). Catherine Bertho Lavenir, partant de l’inventaire réalisé par Dominique Brebion, s’est interrogée sur le devenir des œuvres réalisées à la Martinique au titre du 1% culturel. Elle s’attarde sur les trois statues de femmes destinées au lycée de Bellevue où elles sont désormais placées face à un mur aveugle ! Ce cas particulier est intéressant à la fois parce qu’il interroge sur l’absence fréquente de « désir d’art » chez les responsables des établissements publics qui héritent des œuvres et par ce qu’il sous-entend de la susceptibilité des ex-colonisés, sachant qu’on interprète le plus souvent la statue la plus grande au centre comme une allégorie de la Métropole dominant les deux autres qui figureraient la Martinique et la Guadeloupe. On mentionnera également, pour l’anecdote, l’article de Christelle Lozère sur Maurice Millière (1871-1946), peintre des « reines de beauté » antillaises dans « Le Gai Paris ».
La dernière partie du numéro regroupe trois entretiens d’artistes, Ricardo Ozier-Lafontaine (Martinique), Chantaléa Commin (Guadeloupe) et Thierry Tian-Sio Po (Guyane). Une invitation pour l’amateur familier de leurs œuvres à mesurer l’écart entre la perception qu’ils peuvent eux-mêmes en avoir et les intentions qui ont présidé à leur création. Enfin, on lit sans trop s’étonner mais quand même les propos de Chantaléa Commin lorsqu’elle avoue avoir tiré l’inspiration de certains de ses tableaux du « non-désir » véhiculé par les corps des touristes blancs, comparés par elle à des « Bidochon », sur les plages de son île (p. 203). Un tel White-bashing n’est certes pas dépourvu d’une certaine pertinence esthétique et Ch. Commin prend la précaution de s’abriter derrière des propos tout aussi dépréciatifs de Houellebecq, mais on se prend à imaginer ce que serait sa réaction si un artiste blanc de peau discourait sur le « non-désir » véhiculé par tant de corps antillais en surpoids, qu’il comparerait, par exemple, à des « cachalots » déambulant dans les rues de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France…
Recherches en Esthétique, n° 28, janvier 2023, 252 p., 23 €.

