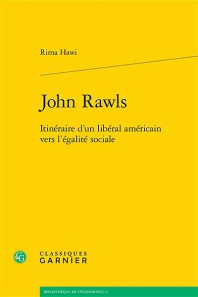 Rima Hawi, John Rawls – Itinéraire d’un libéral américain vers l’égalité sociale, Paris, Classiques Garnier, 2016, 436 p.
Rima Hawi, John Rawls – Itinéraire d’un libéral américain vers l’égalité sociale, Paris, Classiques Garnier, 2016, 436 p.
Bien qu’on ne compte plus les publications en français consacrées à John Rawls (1921-2002), au point que ce dernier n’est pas loin d’avoir stérilisé le débat sur la justice sociale, ses trois (ou deux) principes de justice (selon la manière de compter) étant devenu l’horizon en quelque sorte indépassable de toute réflexion sur le sujet, l’entreprise de Rima Hawi apparaît entièrement légitime. Son livre, issu d’une thèse, combine les approches « archéologique » (les sources et les influences), « historique » (comment la pensée du maître s’est transformée au fil du temps) et « critique » (quelles objections ont été soulevées à l’encontre de la théorie de la justice rawlsienne). Autant dire que l’auteur nous offre une véritable somme, sans égale en langue française.
Une somme où chacun trouvera de quoi nourrir ses propres réflexions. Les philosophes et les penseurs de la politique s’intéresseront, par exemple, à la manière dont Rawls s’est nourri des pensées de Rousseau et de Kant, renouvelant du même coup les interprétations habituelles de ces deux auteurs. Les amateurs de la philosophie morale s’étonneront peut-être de découvrir chez Rawls les conditions suivant lesquelles l’esclavage (bizarrement absent de l’index) pourrait ne pas être injuste (p. 174). Quant aux économistes qui ne sont pas des spécialistes de la théorie du bien-être, la lecture de R. Hawi leur apportera sur ce point certains éclairages originaux.
On connaît essentiellement Rawls en raison du principe, découvert chez l’économiste William Fellner (1965), suivant lequel les inégalités sont admissibles si elles permettent d’améliorer la situation (ou les perspectives selon une autre formulation) des individus les plus défavorisés. On oppose ce principe dit du maximin au principe d’utilité. Dans un cas, en effet, il s’agit de maximiser le bien-être (l’utilité) d’une catégorie (à la limite d’un seul individu), dans l’autre cas de maximiser l’utilité moyenne. En réalité, explique Baumol, il suffit de poser que les fonctions d’utilité sont identiques et que l’utilité marginale est décroissante pour que l’utilitarisme aussi bien que Rawls conduisent au même résultat, c.à.d. à l’égalité parfaite (p. 306) ! Mais l’hypothèse d’identité des fonctions d’utilité n’est-elle pas absurde, les humains ne sont-ils pas tous différents ? Oui et non ! C’est ce qu’explique, pour sa part Harsanyi. Elles sont en tout cas moins différentes qu’on pourrait le penser. Pour rester en France, Pierre Bourdieu n’a-t-il pas bien montré que les préférences que l’on pourrait croire propres à chaque individu sont en réalité fortement dépendantes de son environnement social ? De là à conclure que les fonctions d’utilité sont fondamentalement les mêmes, il n’y a qu’un pas. Que franchit Harsanyi : selon lui, en effet, « utility functions are governed by the same basic psychological » (p. 299).
En tout état de cause, la théorie de la justice rawlsienne butte sur la définition de l’individu le plus défavorisé, puisqu’elle ne retient pas un critère de bien-être unique mais un indice composite. La question se pose alors immédiatement de la construction de cet indice. Le repérage de l’individu le plus défavorisé se complique encore, à l’évidence, dès lors que les fonctions d’utilité ne sont plus tenues pour identiques.
 Les principes de justice de Rawls sont censés être produits par des individus représentatifs placés sous le « voile d’ignorance », un concept utilisé dès 1945 par Vickrey puis par Harsanyi (1953-1955). Ces représentants, des sortes de constituants, font abstraction de leurs atouts ou de leurs handicaps dans la compétition sociale. Comment cela serait possible, Rawls ne le dit pas. Il n’en est pas moins conscient du problème et avoue dans son grand livre, A Theory of Justice (1971), que ses principes pourraient aussi bien être fondés autrement, qu’ils ont le statut d’impératifs catégoriques (p. 185). Or Kant n’avait pas besoin du voile d’ignorance pour édifier sa morale. Il lui suffisait de postuler notre bonne foi.
Les principes de justice de Rawls sont censés être produits par des individus représentatifs placés sous le « voile d’ignorance », un concept utilisé dès 1945 par Vickrey puis par Harsanyi (1953-1955). Ces représentants, des sortes de constituants, font abstraction de leurs atouts ou de leurs handicaps dans la compétition sociale. Comment cela serait possible, Rawls ne le dit pas. Il n’en est pas moins conscient du problème et avoue dans son grand livre, A Theory of Justice (1971), que ses principes pourraient aussi bien être fondés autrement, qu’ils ont le statut d’impératifs catégoriques (p. 185). Or Kant n’avait pas besoin du voile d’ignorance pour édifier sa morale. Il lui suffisait de postuler notre bonne foi.
Quoi qu’il en soit, le voile d’ignorance a suscité de vives contestations qui portent moins sur son caractère artificiel que sur ce que Rawls lui fait dire. Car Rawls ne postule pas que les individus représentatifs sont généreux et bienveillants. Il retient au contraire des homo œconomicus égoïstes. Comment, à partir de là, aboutir à une société régie par le maximin ? C’est la quadrature du cercle, sauf si l’on postule une aversion absolue au risque. Et c’est bien ce qui sera reproché à Rawls, lequel, reconnaissons-le, aura du mal à se défendre : affirmer, comme il le fait, que le maximin est la conséquence inévitable d’une situation – celle du voile d’ignorance – non de risque mais d’incertitude complète paraît un peu court.
R. Hawi présente clairement ces controverses et bien d’autres, même si elle passe un peu vite sur les débats entre Rawls et Sen, son grand concurrent en matière de justice sociale. Ainsi aurait-elle pu davantage souligner que Rawls a fini par intégrer le concept de « capabilité ». Mais il faut surtout rendre hommage à son travail. Un bref compte-rendu d’ouvrage ne saurait pointer tous ses aspects les plus remarquables. « Tout » Rawls est dans le livre (à la seule exception de son ouvrage The Law of people[i]). Nous recommandons au lecteur de poursuivre jusqu’au dernier chapitre, « Une utopie réaliste », dans lequel il est démontré que la doctrine de Rawls n’est pas davantage compatible avec le capitalisme (même amendé par l’État-providence) qu’avec le socialisme d’État (la « dictature du prolétariat ») mais seulement avec soit une « démocratie de propriétaires », soit un « socialisme démocratique » (c.à.d. autogestionnaire), les deux pouvant d’ailleurs se combiner.
Nous n’avons rien dit jusqu’ici du « principe de liberté », pourtant le premier dans l’ordre lexicographique chez Rawls. Il serait dommage de passer par-dessus sans s’y arrêter car il pose deux questions. 1) Les libertés de base considérées par Rawls incluent-elles celle de participer aux décisions en matière de production ? Si l’on répond par l’affirmative à cette question, seul le socialisme démocratique sera retenu comme juste. 2) Le droit de vivre sans travailler (la « liberté réelle » au sens de Van Parijs) fait-il partie des libertés de base? R. Hawi ne considère qu’en passant cette dernière question, pourtant capitale, surtout aujourd’hui quand la fin du travail se profile à l’horizon. Rawls y a partiellement répondu dans Polical Liberalism (1993), ouvrage dans lequel il évoque le cas emblématique du « surfeur de Malibu » qui ne veut surtout pas prendre un emploi. Dans ce cas, suggère Rawls, une évaluation du gain en bien-être qu’il retire du loisir devrait être déduite de son allocation.
Pour terminer, précisons, après R. Hawi, que Rawls a dû admettre que les libertés juridiques rassemblées sous le vocable de « libertés de base » ne sauraient être garanties si chaque membre de la société ne bénéficiait pas d’un revenu décent. Ainsi son premier principe, supposé au départ absolument prioritaire, apparaît-il finalement subordonné à la nécessité « d’assurer, indépendamment du principe de différence, un minimum social qui couvre les besoins essentiels à une vie décente afin qu’il y ait un exercice effectif des libertés de base » (p. 379).
[i]The Law of people (1999) n’est d’ailleurs pas mentionné dans la bibliographie mais seulement la première version embryonnaire de 1993. Cet ouvrage ayant fait l’objet de peu de commentaires, nous nous permettons de renvoyer à notre article : « Une théorie normative de l’aide au développement », Région et Développement, n° 26, 2007, p. 131-145 et http://www.creum.umontreal.ca/IMG/pdf_Herland.pdf

