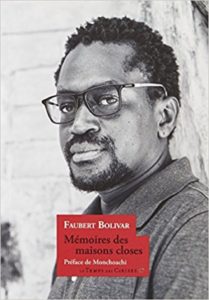 Portes du ciel
Portes du ciel
Un poète, et puisqu’il lui est interdit de discourir par la loi suprême autant qu’implicite qui le régit et que parfois, comme par provocation ou par impérieuse nécessité aussi bien, il enfreint, lâchant bride à son terrible et exigeant coursier, se doit de faire paraître, sinon par l’aplomb du marqué des mots au sol, par le timbre de son galop impétueux, du moins par l’aire que son souffle circonscrit, les contours du royaume lequel dans son sillage il nous fait signe de défricher, le ciel sous lequel il nous convie à habiter,
lors donc que ce n’est pas la langue qui imprime par sa remarquable frappe une telle cadence, un tel marqué-pas aux choses, les disposant et configurant en singulière manière de sorte que par retour, par façon d’un toucher sensible nous voici là – même à même, vlopé flap, emballé en un univers,
c’est l’air lors que le poète va chanter qui va crier l’atmosphère propice à la disposition d’un univers.
Or, s’il nous convie à déambuler en ses Maisons Closes, le présent poème, d’évidence, n’a pas propos de nous y faire mener une existence contrainte de reclus solitaire. Car, à tourner en rond, de maison close en maison close, nous voici, sans y avoir pris garde, mis au rythme de la terre et à même dès lors de l’entendre nous parler. Cependant, une fois mis au rythme de la terre, c’est étrangement nous à présent qui, par la voix du poème, lui parlons. Et nous lui parlons tout simplement parce que nous lui répondons. L’un et l’autre, la terre et les hommes, au même rythme, dansent ensemble, ce qui est proprement « parler ». Parler, c’est danser avec le monde :
« Si la terre tourne en rond
c’est pour te parler
À tourner sur elle-même
elle cherche tes mots »
sont d’ailleurs les premiers vers du recueil. Et ils disent, sans ambages, que « pour te parler », la terre a besoin de « tes mots ». La terre, elle, tournant en rond, donne le rythme. C’est sa façon à elle de parler. Mais le rythme n’est pas rien : sans rythme nous ne pouvons tout bonnement pas parler, tout juste pouvons-nous langager.
Parler c’est chanter, et c’est chanter au rythme de la terre pour l’enlacer et danser. Car elle ne tourne en rond que pour chercher nos mots et, à force – à force, si ça ne tournait pas rond pourrait-elle bien se lasser un jour et s’arrêter de tourner.
Les deux premières et principales parties du présent recueil sont titrées Marelle et Alphabet. La marelle, comme on sait, est un jeu qui se joue en sautant à cloche-pied tout en poussant de case en case du pied qui repose un petit caillou sur un échiquier tracé sur le sol. Le joueur avance soutenu par le rythme du chant des assistants. Il s’agit pour lui remontant d’un bout de l’échiquier à l’autre, d’aller de la terre jusqu’au ciel.
Au jeu de la marelle peut s’apparenter l’alphabet, les lettres constituant les cases que l’écriture, en se déroulant, assemble une à une pour former mots puis phrases, ces
« Folles phrases
qui disent tes pas
dans ma main » …
« des phrases
qui vont en mer
comme les îles que je tutoie ».
Atteindre le ciel au jeu de la marelle requiert d’associer de bout en bout sans désemparer un bon équilibre à de justes impulsions du corps, de combiner avec bonheur l’un et les autres, bref, que de leur accord se profile, gracile, volatile, un rythme certes, dès lors qu’à cet accord, en ce jeu, à parvenir au ciel, adamique
« Un prénom te suffit,
Marelle renie noms,
pronoms vêtements, sous-vêtements »,
quand l’écriture, d’« une main de sable », jouant l’alphabête à Vanity faire, une à une, égrener les lettres, les articuler en mots homophones pour, arc-boutée à leur balancement, « flotter au vent », « voler des déserts du monde » jusqu’au « poème dévoré par le sable ».
Le poème est ciel. Étant ciel, il répand l’influence du ciel. Il instaure la mesure et il est attente infinie. Il est la mesure des « voix (qui) palpitent comme des clous dans la panse des chimères ». Il aspire aux temps où l’homme « inhalait les vents », tout en redoutant que, quelque jour, il n’y ait
« plus de chant
qu’un champ de rien »
pour autant que la terre, cessant s’harmoniser avec la mesure du ciel, se hasarde
« un soir de coup de dés
……………………………………….
en rut de n’ (…) être
qu’un pronom relatif »
se hasarde de n’y plus répondre, contrariant en sorte l’ordre musical de l’univers.
Le poème est ciel. De terre, de l’enclume sacrée, de la trame, prenant son élan et son chant, il monte faire briller ses yeux étoilés, veiller sur le flux tournant sacré, et montant, il se « disjoint de la mémoire de l’alphabet », il se résout en souffle maître des chemins,
dès lors s’épanche et essaime colorer le pelage de la mer, se distiller en îles* . Les Maisons Closes, ici, ouvrent sur les portes du ciel.
* Odysseus Elytis.

