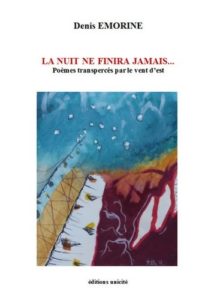 La hantise de la mort
La hantise de la mort
Poète, romancier, essayiste, nouvelliste et dramaturge français contemporain, Denis Emorine ne cesse de s’interroger sur la fatalité de l’Histoire et l’identité brisée dans son nouveau recueil La nuit ne finira jamais (Éditions Unicité, 2019, 73 p.) dont le titre et le sous-titre nous font penser aux obsessions qui traversent comme un vent glacial son écriture: la mort et l’exil.
« La nuit sans fin » est l’ombre de la mort qui vient d’un passé torturant dont il ne peut se libérer, de la douleur d’une blessure incurable qui perce sans cesse son âme, l’empêchant de jouir de la vie, de l’amour.
Présent et passé se heurtent continuellement dans ses vers, la mort et la vie, inséparables et déchirantes, l’âme se replie, harcelée par des souvenirs trop cruels. Tout appel au secours lancé à la femme aimée, consolatrice et protectrice, s’avère impuissant face aux démons intérieurs qui s’emparent du poète. Il restera définitivement marqué par la guerre et par l’Est où il s’est découvert des racines slaves qui l’ont mené à s’imprégner de la grande culture russe. Le vers tout aussi troublant que douloureux « La mort vient de l’Est » annonce l’un des leitmotivs de ses poèmes.
Sous la pression d’une accélération temporelle, le poète se hâte de se livrer à la confession par une voix poétique délivrante, qui s’ouvre vers l’abysse intérieur. Les mêmes fantasmes de Prélude à un nouvel exil (2018) semblent surgir du labyrinthe du soi: la guerre, le fusil, le petit orphelin, la Russie, les morts, la mère, le poète, la femme aimée, la mort omniprésente qui guette de partout, de « derrière chaque fenêtre», dans une poursuite harcelante.
Ce qui ne finira jamais, c’est aussi la douleur de la rupture, de la perte, de l’absence, de l’exil, de l’amour outragé par l’Histoire qui hante sans cesse la conscience du poète. Le souvenir de la mort, le trou noir de sa mémoire affective, écarte toute joie et rend fou de désespoir, car les spectres du passé ne cessent de le hanter. Aucun refuge pour lui, ni même dans l’amour, assombri par le spectre de la mort. Comme un enfant effrayé, il aimerait retrouver la chaleur des bras maternels ou de la femme aimée pour le protéger contre le mal, contre ce qu’il ne peut oublier : « Retiens-moi encore/ je t’en prie/ n’ouvre pas les bras/ Étrangle-moi s’il le faut/ puisqu’il n’y a plus de refuge. »
Le poète conjure l’amour de lui offrir sa protection, mais c’est en vain, la torture ne finit pas, les souvenirs ne disparaissent pas. Ils reviennent avec plus de force, agressent continuellement sa cervelle à le rendre fou, un cauchemar d’où il ne peut sortir que par l’écriture: « Au fond de mes cauchemars/ le même train s’élance en hurlant/ sur les rails fourchus/ c’est le train de la mort/ qui caracole vers l’Est pourtant/ il ne sert à rien de me dissimuler/ entre mes draps sanglants/ il me désigne du doigt celui/ que je voudrais oublier/ on l’a arraché aux bras/ de la jeune femme brune aux yeux bleus/ qui hurle encore son nom/ sous la terre balafré de croix noires/ alors que je me débats en vain/ contre moi-même »
La douceur de l’amour est toujours étouffée par un chagrin incurable que rien ne pourrait vaincre, issu de l’exil intérieur, de la fracturation de l’identité, partagée entre l’Ouest et l’Est, thème récurrent de sa poésie : « Il y a si longtemps/ que j’habite l’isba du chagrin. »
Les poèmes laissent deviner le dialogue déchirant de l’identité/ l’altérité à travers une voix plurielle: je lyrique, tu féminin, il, cet autre lui-même, l’enfant d’autrefois qui l’habite ou il, le poète adulte face à son écriture, elle la mère, il le père ou l’alter, le poète russe avec lequel s’identifie une partie du moi dans le requiem pour l’Est.
Les femmes appelées par leur prénom ou nom et prénom dans les dédicaces, réelles ou inventées, avec un sentiment de nostalgie face à ses images floues de l’amour, toujours délicat, jamais passionnel. Elles semblent des épiphanies d’un archétype féminin recherché par l’homme depuis toujours pour le délivrer du sentiment du néant: « Je voudrais m’accrocher une dernière fois/ à ta main tendue/ mais je n’attrape que le vide ». L’image de la jeune femme brune aux yeux bleus revient souvent à côté d’un petit enfant, souvenir douloureux de la mère et de lui-même.
De la nuit du chagrin sans fin où le poète sombre, un lieu privilégié se fraye chemin lumineux dans sa mémoire, le Jardin du Luxembourg, lieu de rencontre heureuse de la femme idéale, l’anima de l’homme en psychanalyse. Ce rayon merveilleux éclaire de temps en temps le tunnel des souvenirs sombres dans lesquels s’enlise à jamais le poète.
S’il ne peut pas se débarrasser du passé, ni apprendre à l’apprivoiser pour vivre avec lui sans en être tracassé, il aura les mots comme seule consolation à libérer ses fantasmes dans l’écriture aussi illusoire que la vie : « les mêmes cauchemars apprivoisent tes nuits/ arrosées de deuil/ vivre est un outrage/ et l’écriture une excuse trop facile/ pour ne pas s’endormir les poings serrés. »
Le recueil débute et s’achève avec une page en prose. Celle du début parle d’un quai de gare où une plaque incrustée sur un mur rappelle la guerre. La page finale se veut un autoportrait, celui d’une voix poétique qui s’interroge sur la vie et l’écriture.
Denis Emorine, La Nuit ne finira jamais – Poèmes transpercés par le vent d’est, Ed. Uunicité, 70 p., 13 €.

