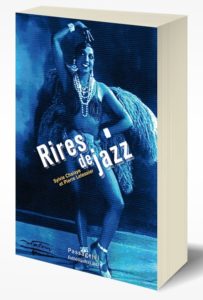 La collection « Esthétique(s) jazz » dirigée par Sylvie Chalaye et Pierre Letessier est vouée aux esthétiques des arts de la scène et de l’image qui s’avèrent influencés, inspirés, ou traversés par le jazz. Ce 1er volume qui regroupe quatorze contributions est divisé en cinq parties (Le rire ontologique du jazz : les facéties en noir et blanc du blackface ; Le jazzman et le clown ; Jazz aux éclats : rires et déconstructions ; Les corps jazz d’acteurs comiques ; Les rires des musiciens de jazz). On trouvera ci-après la postface de Pierre Letessier.
La collection « Esthétique(s) jazz » dirigée par Sylvie Chalaye et Pierre Letessier est vouée aux esthétiques des arts de la scène et de l’image qui s’avèrent influencés, inspirés, ou traversés par le jazz. Ce 1er volume qui regroupe quatorze contributions est divisé en cinq parties (Le rire ontologique du jazz : les facéties en noir et blanc du blackface ; Le jazzman et le clown ; Jazz aux éclats : rires et déconstructions ; Les corps jazz d’acteurs comiques ; Les rires des musiciens de jazz). On trouvera ci-après la postface de Pierre Letessier.
Au terme de notre enquête sur les rires de jazz, la somme des échantillons sonores et de leurs analyses confirme le titre pluriel du volume. Il n’y a pas un mais plusieurs rires de jazz. Ce qui s’est traduit par un champ d’études particulièrement large. Si on peut distinguer trois grands types de rires en général, celui qui exprime des émotions (la joie, la colère…), celui qui marque un mode de communication sociale (le rire de connivence et d’intégration, ou au contraire, celui qui marque un écart avec une situation ou un groupe) et celui qui est produit par le comique, les chapitres qui composent ce volume ne se limitent pas – comme tel est souvent le cas[1] – au troisième, mais envisagent (tout en privilégiant néanmoins ce dernier) les trois types de rires. Et, aussi par voie de conséquence, les rires étudiés y sont aussi bien ceux des auditeurs/spectateurs que ceux des artistes eux-mêmes.
Pluralité des rires ne signifie donc pas simple variété. Il est possible au contraire de distinguer dans cette pluralité des lignes de sons et de sens particulières, qui toutes réunies dessinent une identité propre aux rires de jazz… et donc au jazz aussi. Ne reconnaît-on pas quelqu’un à son rire ? De ces lignes de sons et de sens, nous en retracerons trois en forme de conclusion.
La première ligne est celle de l’ambivalence des rires, qui suppose que ceux-ci ne sont pas le simple produit d’un effet comique, mais font référence, d’une façon plus ou moins délibérée, à un sentiment ou une situation douloureuse ou même insupportable. Cette réversibilité des rires, qui est déjà celle du blackface, et que la première partie du volume étudie, se retrouve dans de nombreux chapitres. Si Bergson pose dès le début de sa première étude sur Le Rire un degré d’insensibilité ponctuelle comme préalable au rire, il semble que ce degré soit particulièrement réduit dans le jazz, et que l’idée d’un monde effondré et en perte de sens se fasse entendre à travers ces éclats sonores. Rire pour ne pas pleurer… Est-ce parce que, même si le jazz a échappé aujourd’hui à son référent historique qu’est l’histoire des Noirs en Amérique, ce référent est pourtant encore présent ? Ce n’est pas un hasard du moins si des convergences ont pu apparaître entre l’existentialisme européen et la culture africaine-américaine autour du sentiment de l’absurde[2]. Dans un monde désenchanté, dans un quotidien violent et chaotique, les rires prennent alors souvent un sens particulier, dans la mesure où ils constituent une défense et une action pleines de fragilité et de panache. La dimension transgressive du rire jazz, comme façon de dénoncer, de dire non et de déconstruire est une force dévastatrice, mais qui ne tient pourtant bel et bien qu’à un simple rire. Le dramaturge Koffi Kwahulé, qui affirme écrire jazz, ne dit pas autre chose :
Faire du jazz, c’est contester ce qui est arrêté et qui semble figé à jamais. C’est un grand rire dans le monde, une faille. C’est pour cela que j’aime tant Armstrong et Dizzy Gillespie, leur rire éclatant devant ce monde qui fait tout pour oublier sa faiblesse.[3]
Si le rire a été le premier lien culturel entre les Blancs et les Noirs américains, le rire est aussi plus largement – quelle que soit la couleur de sa peau – un lien au monde, une façon d’être au monde et de le dire. Et on comprend mieux peut-être pourquoi, au-delà de son simple goût personnel, le désabusé et angoissé Woody Allen met du jazz dans tous ses films, qu’ils soient comiques ou non.
La deuxième ligne relie les rires et les corps. Le comique lié au jazz engage en effet souvent les corps pleinement, de façon énergique, exubérante, loufoque et volontiers excessive. Qu’on songe aux exemples donnés au fil des chapitres de ce volume, de la « Revue nègre » aux films de Jerry Lewis, en passant par Hellzapoppin et les scopitones d’Henri Salvador. Ou aux ciné-concerts d’aujourd’hui : dès qu’il s’agit d’accompagner un film burlesque, ne fait-on pas encore appel quasi systématiquement à des musiciens de jazz[4] ? Cet engagement excessif et excentrique du corps constitue peut-être une forme de réponse à l’ambivalence dont nous venons de parler. Il constitue du moins une caractéristique de cette forme de musique, qui s’est distinguée aussi précisément parce qu’elle « réintroduisait le corps dans la musique, lui donnait du corps dans des lieux qui semblaient plutôt conçus pour lui en ôter (salles de théâtre, de concert, voire d’opéra)… »[5]. Pour trouver de nouveaux sons et de nouvelles façons de jouer, les musiciens de jazz eux-mêmes exécutent ainsi souvent des gestes bizarres et exubérants (ceux-là mêmes dont Jerry Lewis s’inspire), qui sont d’ailleurs décrits à plusieurs reprises dans ce volume comme des mouvements de danse. Les musiciens de jazz ont tendance à danser leur musique quand ils la jouent. Le jazz reste ainsi une musique à voir, une musique spectacle, non seulement parce que les musiciens jouent avec leur corps, mais aussi parce qu’ils s’écoutent d’une écoute particulière, liée à la part d’improvisation[6], qui est corporelle. Bien plus, cet engagement du corps est partagé par les spectateurs/auditeurs, qui de façon plus ou moins perceptible hochent de la tête ou du buste, tapent du pied ou de la main… ou rient avec les musiciens. Quand il surgit, le rire qui secoue les corps donne à voir précisément cette énergie corporelle des musiciens. Mais il est donc aussi un mode physique et sensible de partage et d’échange, entre les musiciens eux-mêmes, entre les auditeurs / spectateurs, et entre la salle et la scène. Un mode universel de communication qui ne renvoie pas (forcément) à un quelconque comique, mais matérialise et performe le concert et le plaisir physique du moment. De ce point de vue, une blague énoncée avant un morceau ne vise pas seulement à détendre l’atmosphère en faisant rire le public, elle constitue une sorte d’échauffement corporel et sonore partagé qui met en corps tous les participants.
La troisième ligne, liée à la deuxième, est celle de l’improvisation. Plusieurs chapitres ont fait le lien entre les rires et l’improvisation. Parce que le mouvement même de sortir d’un cadre, d’impulser du vivant dans une mécanique donnée, peut avoir une force comique. De ce point de vue, « le free jazz est drôle »[7]. Si on ne rit pas fort, on jubile du moins intérieurement et cette joie ne se réduit pas aux sorties de cadres qui surprennent l’auditeur/spectateur. Car l’improvisation met en place un plaisir de la variation, qui est plaisir non seulement de la surprise, mais aussi de son attente – celui de l’attente de l’inattendu donc. Ainsi, on se prépare avec plaisir à entendre et pressentir le moment où un musicien sort du cadre de façon imprévisible, mais aussi à retrouver ce cadre au moment où on le croyait disparu, tout en sachant qu’on risquait bien de le retrouver… Bref, la variation suppose un plaisir incessant de la reconnaissance et de la surprise, elle fait du jazz une expérience temporelle suspendue jouissive, celle d’une durée qui semble rebondir[8] sans cesse grâce précisément aux libertés apportées par l’improvisation de tel ou tel musicien qui créent aussitôt d’autres surprises et d’autres attentes. De ce point de vue, le jazz est une musique joyeuse, qui s’écoute avec un sourire (intérieur) toujours susceptible de s’extérioriser en rire au moment d’un passage particulièrement intense. Ces rires, qui peuvent être aussi bien ceux des musiciens que ceux des auditeurs/spectateurs, ont leur place dans la performance jazz, parce que la partition n’est jamais totalement écrite précisément, et que l’improvisation ouvre le temps et permet aux rires de s’y glisser : ils constituent des respirations sonores qui signalent volontiers la fin d’un intense mouvement improvisé, et s’ajoutent d’ailleurs souvent aux applaudissements. Pour toutes ces raisons, si les rires peuvent être la signature sonore de certains musiciens (et de certains spectateurs/auditeurs), ils constituent souvent dans leur diversité même une signature sonore du jazz.
[1] C’est le cas du Rire de Bergson.
[2] Voir E. Parent, « Humour et signifying dans la tradition américaine », in F. Hofstein (dir.), L’Art du jazz, Éditions du Félin, 2011, p. 94-97.
[3] K. Kwahulé et G. Mouëllic, Frères de son – Koffi Kwahulé et le jazz : entretiens, éd. Théâtrales, 2007, p. 54.
[4] Le jazz est contemporain du cinéma, mais le lien entre le jazz et le cinéma burlesque (qui ne se réduit pas au cinéma américain) n’est pas seulement historique, de même qu’il ne se réduit pas à l’improvisation qui permet au musicien jazz de suivre le film.
[5] J. Jamin et P. Williams, « Présentation. Jazzanthropologie », L’Homme, 2001/2, n° 158-159, p 16.
[6] Ce que Pierre Sauvanet appelle un « échange authentique » : C. Duflo et P. Sauvanet, Jazzs, MF, 2008, p. 159.
[7] P. Carles et J.-L. Comolli, Free jazz – Black power, Gallimard, 2000 [1ère édition : Champ libre, 1971], p. 18.
[8] C. Duflo et P. Sauvanet, op. cit., p. 158.

