Portrait d’une femme à la recherche d’elle-même et de sa vérité
 Nous guider ou nous perdre dans le labyrinthe des identités multiples, telle est la mission que Stéphane Braunschweig dit attribuer à ses acteurs lorsqu’il monte à l’Odéon, en janvier 2021, la pièce de Luigi Pirandello, Comme tu me veux, dans sa propre traduction. Un compagnonnage fidèle entre le dramaturge et le metteur en scène, puisque ce dernier a déjà donné au théâtre Vêtir ceux qui sont nus, Six personnages en quête d’auteur et Les Géants de la montagne. Comme tu me veux fait escale au Théâtre National de Bretagne, en ce mois de février 2023, et c’est un bien que les spectacles sortent de leur pré carré parisien et voyagent jusque dans nos “provinces”…
Nous guider ou nous perdre dans le labyrinthe des identités multiples, telle est la mission que Stéphane Braunschweig dit attribuer à ses acteurs lorsqu’il monte à l’Odéon, en janvier 2021, la pièce de Luigi Pirandello, Comme tu me veux, dans sa propre traduction. Un compagnonnage fidèle entre le dramaturge et le metteur en scène, puisque ce dernier a déjà donné au théâtre Vêtir ceux qui sont nus, Six personnages en quête d’auteur et Les Géants de la montagne. Comme tu me veux fait escale au Théâtre National de Bretagne, en ce mois de février 2023, et c’est un bien que les spectacles sortent de leur pré carré parisien et voyagent jusque dans nos “provinces”…
Nous perdre, la comédienne Chloé Réjon, qui incarne l’Inconnue, – jamais explicitement nommée, mais à qui seront attribués dans l’histoire deux prénoms différents –, figure centrale, omniprésente sur scène, toute en mouvements, errements et émotions diverses, s’y attache et y parvient sans peine. Quand se clôt la représentation, nul ne saurait affirmer avec certitude qui est cette Femme, le spectateur pas davantage que ses compagnons de jeu. Jeu, jouer, se jouer des autres et de soi, mener le jeu enfin, le mot prend une force cruelle quand il est l’apanage de celle qui, blessée par l’existence, humiliée par “ses frères humains”, n’ayant plus d’identité affirmée, souffle le chaud et le froid, prétendant « n’être plus qu’un corps sans nom ». De Chloé Réjon, vibrante telle la flamme sans cesse renouvelée, sans cesse renaissant de ses cendres, il fallait bien l’énergie, l’aisance de déplacements, la souplesse du corps et d’un visage traversé de mille émotions, pour donner vie et crédibilité à ce personnage de femme torturée, en qui visiblement elle a foi.
En 1928, Pirandello s’est volontairement exilé pour un temps en Allemagne, où il écrit la pièce. C’est à Berlin qu’il situe l’acte premier, dans le contexte de l’Entre-deux-guerres, alors que commencent à se faire menaçants les totalitarismes, nazisme allemand et fascisme italien. Des images d’archives projetées, en nombre raisonnable, qui montrent des villes sous les bombardements, un Mussolini éructant et des foules en délire, nous situent dans le temps. Un temps où Elma danse et se grise de champagne, dans l’un de ces cabarets berlinois, populaires, de l’époque. Un temps où elle semble vivre dans la décadence et la débauche, maîtresse d’un écrivain célèbre qui pour elle a quitté son épouse. Mais Elma danse au bord du vide, comme ces États qui se relevant de la Grande Guerre et se reconstruisant ne veulent pas voir les dangers en gestation. Elma ! L’Inconnue s’est donné ce prénom, et le mot en arabe est censé désigner « l’eau », et sa vie fuit comme l’eau qu’on ne saurait entre ses doigts retenir. Pourtant, cernée par une troupe en noir et blanc de noceurs éméchés, elle seule resplendit dans sa légère tenue argentée, quand s’ouvre le spectacle sur un tableau d’abord figé, – qui pourrait évoquer certaine œuvre du peintre Otto Dix –, dans un espace nu, étouffé de lourds rideaux verts, délimité au centre du plateau. Des rideaux qui tomberont bientôt… et l’on espérerait qu’une vérité se révèle, puisque Boffi, le photographe venu d’Italie et d’avant la Grande Guerre, a prétendu en Elma reconnaître Lucia. Sous ce prénom de Lucia, l’Inconnue serait l’épouse, depuis dix ans disparue, de son ami Bruno Pieri, que l’on a crue morte, ensevelie peut-être sous des décombres, ou emmenée par les soldats qui, lors de l’occupation de la Vénétie par l’armée austro-hongroise, ont détruit la villa du couple.
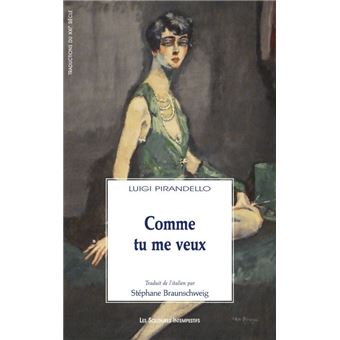 Ellipse… dans le temps et l’espace, qu’une scénographie habile matérialise, le centre du plateau, le long duquel glissera Elma/Lucia, se soulevant pour découvrir une fosse. Et ce gouffre révélé, s’il permet le changement de lieu puisque nous entrons alors en Vénétie, symbolise tout à la fois la destruction qu’engendrent les guerres, l’amnésie supposée de celle qui aurait perdu la mémoire, ou le vide qui s’est creusé au cœur d’une femme victime de sévices, maltraitée, violentée, « massacrée dans votre chair, avec toutes les abominations que vous savez, et suppliciée dans votre âme ». Le gouffre se refermera, mais chacun sait désormais qu’il est là, béant, sous nos pieds. Le décor est à présent un vaste salon cerné de voiles blancs, qui accueille sur trois côtés des canapés où viendront prendre place les personnages. Lieu sans âme ni chaleur, écrin maléfique, piège où se découvre à Elma/Lucia une sombre histoire d’intérêts, puisqu’il faut, pour préserver ces intérêts, qu’elle redevienne, vraie ou fausse, la femme de Bruno. Puisqu’elle est un enjeu au sein de cette famille. Les voiles du décor une fois tombés restera, seul, suspendu, intangible imposant sa présence, le portrait de Lucia. Lucia comme la Sainte de la lumière, lumière perdue et qu’il faudrait mais qu’on ne sait retrouver ? Sous le portrait viendra s’asseoir le double de l’Inconnue, sa face enfouie, occultée, la femme perdue de raison que l’amant de Berlin a exfiltrée de l’asile, qu’il conduit en Vénétie au prétexte qu’elle serait la véritable épouse de Bruno. Va-t-on confondre l’Inconnue, elle qui affirme « ne plus vouloir se connaître » ? Démasquer une imposture, imaginaire ou réelle ? Elma/Lucia est-elle retorse, calculatrice, ou plus simplement amnésique ? Qui est-elle entre aveux et mensonges ? L’énigme ne trouvera pas sa solution, laissant perplexe la spectatrice que je suis !
Ellipse… dans le temps et l’espace, qu’une scénographie habile matérialise, le centre du plateau, le long duquel glissera Elma/Lucia, se soulevant pour découvrir une fosse. Et ce gouffre révélé, s’il permet le changement de lieu puisque nous entrons alors en Vénétie, symbolise tout à la fois la destruction qu’engendrent les guerres, l’amnésie supposée de celle qui aurait perdu la mémoire, ou le vide qui s’est creusé au cœur d’une femme victime de sévices, maltraitée, violentée, « massacrée dans votre chair, avec toutes les abominations que vous savez, et suppliciée dans votre âme ». Le gouffre se refermera, mais chacun sait désormais qu’il est là, béant, sous nos pieds. Le décor est à présent un vaste salon cerné de voiles blancs, qui accueille sur trois côtés des canapés où viendront prendre place les personnages. Lieu sans âme ni chaleur, écrin maléfique, piège où se découvre à Elma/Lucia une sombre histoire d’intérêts, puisqu’il faut, pour préserver ces intérêts, qu’elle redevienne, vraie ou fausse, la femme de Bruno. Puisqu’elle est un enjeu au sein de cette famille. Les voiles du décor une fois tombés restera, seul, suspendu, intangible imposant sa présence, le portrait de Lucia. Lucia comme la Sainte de la lumière, lumière perdue et qu’il faudrait mais qu’on ne sait retrouver ? Sous le portrait viendra s’asseoir le double de l’Inconnue, sa face enfouie, occultée, la femme perdue de raison que l’amant de Berlin a exfiltrée de l’asile, qu’il conduit en Vénétie au prétexte qu’elle serait la véritable épouse de Bruno. Va-t-on confondre l’Inconnue, elle qui affirme « ne plus vouloir se connaître » ? Démasquer une imposture, imaginaire ou réelle ? Elma/Lucia est-elle retorse, calculatrice, ou plus simplement amnésique ? Qui est-elle entre aveux et mensonges ? L’énigme ne trouvera pas sa solution, laissant perplexe la spectatrice que je suis !
Si la pièce me semble un peu désuète, un peu bavarde et cérébrale, – encore que Chloé Réjon sache fort bien faire entendre, rendre crédible et troublante cette logorrhée hachée, en mots qui se cherchent, se précipitent, se bousculent –, elle garde une cruelle actualité, qui nous parle des traumatismes de la guerre, de leur survivance. De la difficulté aussi à se forger une identité, sous le regard des autres. De la folie enfin, dont s’accusent à maintes reprises les personnages de cette intrigue – existentielle, ou tragique, ou policière ? : « … chez les humains, c’est atroce cher monsieur ! – la nature vire à la folie… heureusement qu’on a encore la raison comme camisole de force… ». Mais, dira Lucia, « on ne voit plus la raison de se dépouiller des voiles colorés de la folie ».
P.S : la traduction de Stéphane Braunschweig est parue aux éditions Les Solitaires Intempestifs.
Rennes, le 6 février 2023
Photo Paul Chéneau

