 Le bilan de la colonisation restera toujours controversé entre ceux qui vantent plutôt ses mérites, les progrès qu’elle a apportés en matière technique et dans le domaine du droit et ceux qui insistent au contraire sur la violence qui s’est exercée sur les hommes et les femmes colonisés et sur leur culture. L’ouvrage récemment publié de Ho Hai Quang est un plaidoyer uniquement à charge contre la colonisation de l’Indochine et plus précisément de la Cochinchine, la partie sud du Vietnam actuel englobant Saigon (Ho Chi Minh Ville) et le delta du Mékong. Disons tout de suite que ce n’est pas parce qu’il ne considère qu’un seul côté des choses que cet ouvrage devrait être disqualifié par les tenants du bilan globalement positif de la colonisation. Car l’auteur fait preuve d’historien et les faits sont têtus. Aucun jugement de valeur n’accompagne d’ailleurs les éléments qu’il verse au dossier. Comme Marx, dont il se réclame dans cet ouvrage, H. H. Quang constate simplement que le développement du capitalisme s’est accompagné de procédés que nous qualifierions aujourd’hui de barbares. Les faits parlent suffisamment d’eux-mêmes et il est bon qu’ils soient connus.
Le bilan de la colonisation restera toujours controversé entre ceux qui vantent plutôt ses mérites, les progrès qu’elle a apportés en matière technique et dans le domaine du droit et ceux qui insistent au contraire sur la violence qui s’est exercée sur les hommes et les femmes colonisés et sur leur culture. L’ouvrage récemment publié de Ho Hai Quang est un plaidoyer uniquement à charge contre la colonisation de l’Indochine et plus précisément de la Cochinchine, la partie sud du Vietnam actuel englobant Saigon (Ho Chi Minh Ville) et le delta du Mékong. Disons tout de suite que ce n’est pas parce qu’il ne considère qu’un seul côté des choses que cet ouvrage devrait être disqualifié par les tenants du bilan globalement positif de la colonisation. Car l’auteur fait preuve d’historien et les faits sont têtus. Aucun jugement de valeur n’accompagne d’ailleurs les éléments qu’il verse au dossier. Comme Marx, dont il se réclame dans cet ouvrage, H. H. Quang constate simplement que le développement du capitalisme s’est accompagné de procédés que nous qualifierions aujourd’hui de barbares. Les faits parlent suffisamment d’eux-mêmes et il est bon qu’ils soient connus.
Ce livre issu d’une thèse de doctorat étudie la période qui va de 1859, c’est-à-dire depuis la conquête de Saigon, jusqu’à 1930, lorsque la colonisation économique a enfin abouti sous la forme de grandes plantations d’hévéas financées par des capitaux en grande partie métropolitains. Le livre explique précisément comment s’est effectuée la transition entre une économie au départ presque entièrement paysanne et un mode de production capitaliste, lequel, à considérer le traitement réservé à la main d’œuvre, paraît tout aussi inhumain que lors des premiers temps de la révolution industrielle en Europe.
Après quelques rappels théoriques sur l’accumulation du capital, l’auteur décrit la situation de la Cochinchine au moment où les Français arrivent dans le pays. Il récuse la terminologie souvent utilisée de mode de production asiatique (MPA), lui préférant l’expression qu’il crée de « servage tributaire ». C’est un point sur lequel les spécialistes pourront discuter tant la différence paraît ténue entre ce qu’il décrit et la version chinoise du MPA, celle qui sert habituellement de référence. Ce d’autant que le sud de l’Indochine fut conquis dès le XVIIe siècle par des Viet appartenant eux-mêmes à la sphère d’influence chinoise. En favorisant la propriété privée les Français ont bousculé ce système où les terres étaient pour la plupart de propriété communale et redistribuées périodiquement entre les familles en fonction des forces de chacune. Il fallait bien de la main d’œuvre et des terrains pour les colons, même si ces derniers s’installèrent le plus souvent sur des terres vierges.
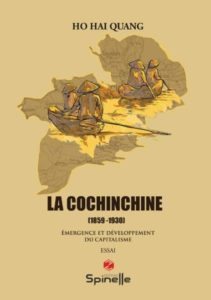 H.H. Quang utilise toutes les sources disponibles pour dépeindre les conditions des uns et des autres. A la lumière des chiffres qu’il présente, confortés par des rapports d’inspection, les avantages consentis aux fonctionnaires français paraissent exorbitants, avec des traitements cinq fois supérieurs à ceux de leurs homologues à la Métropole plus les avantages en nature. On pense immédiatement à la mère de Marguerite Duras qui avait pu avec sa solde et sa pension de réversion acquérir une concession au Cambodge (même si, en l’occurrence, cette entreprise ne fut pas un succès). Encore une institutrice était-elle obligée d’enseigner, ce qui n’était guère le cas pour les autres fonctionnaires à en croire un rapport cité dans le livre : « Le fonctionnaire européen, en général, ne donne pas en Indochine la somme de travail qu’il doit à son service, d’où des cadres surabondants et c’est l’agent indigène qui fait et se trouve au courant des détails des bureaux » (sic).
H.H. Quang utilise toutes les sources disponibles pour dépeindre les conditions des uns et des autres. A la lumière des chiffres qu’il présente, confortés par des rapports d’inspection, les avantages consentis aux fonctionnaires français paraissent exorbitants, avec des traitements cinq fois supérieurs à ceux de leurs homologues à la Métropole plus les avantages en nature. On pense immédiatement à la mère de Marguerite Duras qui avait pu avec sa solde et sa pension de réversion acquérir une concession au Cambodge (même si, en l’occurrence, cette entreprise ne fut pas un succès). Encore une institutrice était-elle obligée d’enseigner, ce qui n’était guère le cas pour les autres fonctionnaires à en croire un rapport cité dans le livre : « Le fonctionnaire européen, en général, ne donne pas en Indochine la somme de travail qu’il doit à son service, d’où des cadres surabondants et c’est l’agent indigène qui fait et se trouve au courant des détails des bureaux » (sic).
La colonie a besoin d’argent. Elle se le procurera par des procédés que l’on peut dire contraires à la morale, par exemple grâce à la fiscalité sur l’alcool de riz dont les modalités varièrent avec pour objectif constant de maximiser les recettes (première réglementation dès 1864, création de la ferme des alcools en 1871, production sous licence en 1881, retour à la liberté en 1894, monopole de fait de la Société française des distilleries de l’Indochine après 1902). Mais c’est l’encouragement et même la prise en main du commerce de l’opium qui paraissent les plus répréhensibles (autorisation dès la conquête alors qu’il était proscrit, création de la ferme de l’opium en 1861, régie directe à partir de 1881). Le but de ces réformes successives étant, comme pour l’alcool, d’engranger le plus de taxes sans aucun souci pour la santé publique. Les chiffres indiquent que les ventes (en kg) d’opium ont plus que doublé entre 1890 et 1895 ! Avec les dégâts qu’on imagine. Ici encore on est tenté d’évoquer la famille de Marguerite Duras, son frère Pierre dépendant à l’opium.
L’agriculture coloniale s’est d’abord développée sur une échelle restreinte. Ce n’est qu’à partir du boom du caoutchouc, donc à partir du début du XXe siècle, qu’elle a véritablement pris son essor. Entre 1910 et 1920 la surface plantée en hévéas a été multipliée par presque trois. C’est surtout dans la décennie 1920, donc à la fin de la période couverte par le livre, que les capitaux affluèrent en Indochine. La superficie concédée à des Français est passée en effet de moins de 200 000 ha en 1924 à plus de 400 000 ha en 1930. Quant aux exportations de caoutchouc de la Cochinchine, elles furent multipliées par trois au cours de cette décennie.
Ce que montre surtout l’étude de H. H. Quang c’est que cette croissance de la production s’est accompagnée d’une exploitation éhontée d’une main d’œuvre qu’on devait allait chercher jusqu’en Annam et même au Tonkin. Salaires misérables, travail éprouvant, ce n’est qu’en 1927 que la Colonie prit des arrêtés pour rendre cette exploitation de la main d’œuvre un peu moins inhumaine mais ils ne furent, apprend-on, guère respectés. Comme l’explique fort bien l’auteur, dans le système capitaliste « ordinaire », le salaire doit permettre l’entretien des ouvriers dès leur naissance. Même si historiquement l’exode rural a permis d’échapper partiellement à cette règle, pour les planteurs de Cochinchine de telles entorses étaient la règle, avec donc une « surexploitation » de la force de travail, puisqu’elle était « produite » dans les villages autosuffisants – quoique misérables – et puisque, lorsque les travailleurs – s’ils avaient survécu aux conditions de travail épuisantes – retournaient chez eux, c’est encore le village qui devait assurer leur subsistance.
Ho Hai Quang, La Cochinchine (1859-1930) – Emergence et développement du capitalisme, Editions Spinelle, 2022, 474 p., 18 €.

