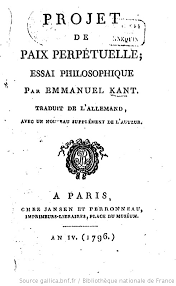 Dans une constitution où le sujet n’est pas citoyen, qui, par conséquent, n’est pas républicaine, c’est la chose la plus aisée du monde [de déclarer la guerre], parce que le chef n’est pas un associé dans l’État, que la guerre n’inflige pas la moindre perte à ses banquets, chasses, châteaux de plaisance, fêtes de cour, etc., qu’il peut donc décider de la guerre pour des raisons insignifiantes comme une sorte de partie de plaisir.
Dans une constitution où le sujet n’est pas citoyen, qui, par conséquent, n’est pas républicaine, c’est la chose la plus aisée du monde [de déclarer la guerre], parce que le chef n’est pas un associé dans l’État, que la guerre n’inflige pas la moindre perte à ses banquets, chasses, châteaux de plaisance, fêtes de cour, etc., qu’il peut donc décider de la guerre pour des raisons insignifiantes comme une sorte de partie de plaisir.
Le texte ci-dessus est extrait de Vers la paix perpétuelle, ce bref ouvrage de Kant écrit en 1795, qui ne permet pas seulement de comprendre pourquoi le président-dictateur Poutine n’a rencontré aucun obstacle pour lancer son « opération spéciale » en Ukraine, au contraire des démocraties européennes où il faut « l’assentiment des citoyens pour décider si une guerre doit avoir lieu ou non ». Kant nous aide également à comprendre pourquoi l’Europe, après la deuxième Guerre mondiale, a commencé à s’organiser et pourquoi la guerre en Ukraine devrait entraîner la constitution d’une véritable défense européenne.
La perspective même lointaine d’une paix universelle s’inscrit comme l’aboutissement d’une ligne de progrès. Mais de quel progrès s’agit-il ? Un progrès moral ? L’histoire du XXème siècle, pour s’en tenir à elle, avec la « boucherie de 14 », la Shoah, le Goulag, les Khmers rouges, etc. ne permet pas de repérer une amélioration significative par rapport au siècle d’Hannibal, par exemple. On est tenté à cet égard de souscrire à la troisième hypothèse de Kant (à côté de celles du progrès ou de la régression en matière morale), celle de « l’abdéritisme » (proposée dans Le Conflit des facultés, 1798), à savoir une marche en avant suivie de rechutes. Mais s’il en est ainsi, comment la paix perpétuelle pourrait-elle être considérée comme un idéal atteignable ? Selon Kant, elle n’adviendra pas à la suite d’un plan préconçu mais finira peut-être par s’imposer d’elle-même.
Au point de départ du raisonnement tel qu’il est exposé dans Vers la paix perpétuelle, se trouve le constat de « l’insociable socialité » qui nous fait désirer la concorde tout en cédant à la discorde. Or c’est justement sur cette contradiction que s’appuie Kant. À l’origine, c’est notre instinct belliqueux qui nous a poussés, explique-t-il, à peupler toute notre planète, y compris les régions les plus hostiles qui furent colonisées par des peuples chassés de leur habitat originel. Kant retrouve alors Hobbes : des États se sont constitués à la fois pour réguler les dissensions intérieures et pour « constituer une puissance armée » à but défensif ou offensif contre les autres peuples. Il n’y a, on le voit, dans la mise en place de ce jus civitatis (les droits civiques) aucune impulsion d’ordre moral. Il en va de même dans la seconde étape, celle du jus gentium, le droit des peuples dans leurs rapports mutuels. Celui-ci inclura au minimum un droit de la guerre. Au-delà, il pourra s’agir d’une véritable « alliance de paix » entre certains États voisins lassés de se faire une guerre sans fin. Un tel foedus pacificum est appelé par Kant une « fédération », alors que l’on parlerait plutôt aujourd’hui d’une simple confédération.
« Ce ne devrait pas être un État des peuples, plusieurs peuples en un État ne formeraient qu’un seul peuple, ce qui (puisque nous avons à examiner le droit réciproque des peuples [qui] forment autant d’États différents) serait une contradiction ». Précisons que selon Kant la séparation entre les peuples est une conséquence naturelle de « la diversité des langues et des religions ».
Bien que Kant, curieusement, ne semble pas apprécier la différence entre ce qu’il nomme une fédération et les États-Unis d’Amérique dont la constitution (1787) va bien au-delà d’une simple alliance de paix, son explication vaut en partie pour l’Union européenne (UE) dans sa configuration actuelle. Certes, la Deuxième Guerre mondiale n’a pas été l’élément déclencheur espéré par les participants du congrès de La Haye (1848) et le projet d’une Communauté européenne de défense (1954) fut également un échec, mais l’inauguration de la Communauté économique européenne (1957) s’inscrit dans la période (1956-1962) pendant laquelle la guerre froide fut la plus intense (voir les crises de Berlin, Cuba, Suez) et où il paraissait important pour les pays de l’Europe occidentale de se rapprocher tout en arrimant la RFA dans leur camp, au-delà du premier pas réalisé avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA, 1952).
Depuis, si l’unification européenne a fait son chemin, l’Europe n’est toujours pas une alliance militaire, celle-ci restant du ressort de l’OTAN. Et si la perspective de la défense européenne devient aujourd’hui plus crédible, ce n’est assurément pas parce que les gouvernements actuels sont plus clairvoyants que les précédents, c’est à l’évidence en raison d’une nouvelle « ruse de la nature », comme écrit Kant (nous dirions plutôt une ruse de l’histoire), soit l’agressivité renforcée de Poutine conjuguée avec la volonté affichée de la part des États-Unis de se désengager. Néanmoins rien n’est acquis, les crispations souverainistes des divers États membres risquant, comme par le passé, d’être les plus fortes.
Quid de la paix universelle ? Si l’on suit la vision kantienne de l’histoire, l’humanité a désormais à peu près atteint le stade de la rivalité entre des blocs réciproquement menaçants. La Chine est en train de constituer son propre bloc face à celui encore dominé par les États-Unis tandis que la Russie a toujours des pays satellites et cherchera à persévérer dans son être, Poutine ou pas Poutine. Il n’est donc pas impossible que l’équilibre de la terreur entre ces trois blocs possédant l’arme atomique conduise à une « alliance de paix » au plan mondial. L’égoïsme naturel, plus précisément « l’esprit de commerce » (ou la « puissance d’argent ») pourraient également y pousser, ajoute Kant, qui reprend ici sans le dire la thèse du « doux commerce » de Montesquieu.
On peut néanmoins estimer qu’un tel équilibre au niveau mondial aurait toutes les chances de se révéler instable. C’est pourquoi Kant conditionnait l’instauration d’une paix perpétuelle à la signature d’un autre foedus, un pacte en bonne et due forme entre tous les peuples organisés chacun en « république », c’est-à-dire dotés d’une constitution garantissant la liberté et l’égalité entre des citoyens qui acceptent une législation commune.
La guerre et la paix sont en réalité l’unique préoccupation de Kant quand il parle de « fédération » puisqu’il reste convaincu de l’impossible fusion des peuples : « Une fédération des États, dont le simple dessein est d’éloigner la guerre, est le seul état de droit conciliable avec la liberté des États ». Il serait donc abusif de voir chez Kant une quelconque paternité de l’idée des États-Unis d’Europe. Quant au jus cosmopoliticum censé régir les relations entre les peuples – une fois acquise la paix universelle – il devrait se limiter selon lui à un seul article portant sur les « conditions de l’hospitalité universelle » qu’il voyait comme un simple « droit de visite ». Kant avait alors en vue les méfaits de la colonisation imposée à des peuples plus faibles mais constater que peuvent se présenter des « visiteurs » indésirables à un titre ou à un autre demeure d’actualité et le principe suivant lequel il revient à chaque peuple (chaque nation, chaque État) de décider qui sera accueilli durablement ou non mérite à coup sûr d’être réexaminé à la lumière des difficultés soulevées par les migrations contemporaines.

