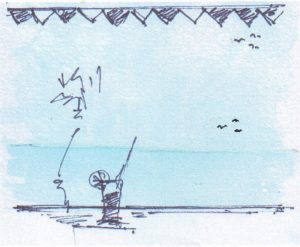 Episode 9
Episode 9
Beach Brother
L’océan se laissait aller jusqu’à la plage en formant de gros rouleaux bourrés d’écume qui se couraient après avant de capoter sur le sable. C’était sans doute ce qui avait dû les attirer : les surfeurs.
Les camionnettes qui leur servaient d’hôtels étaient décorées de hiéroglyphes et d’autocollants touristiques qui racontaient leurs voyages.
Gary était Australien avec des tatouages polynésiens. Il était passé dans pas mal d’endroits où les vagues, la terre et les humains-surfeurs vivaient en bonne harmonie mais, depuis quelques années, la prolifération bruyante des dispositifs de sécurité (sirènes, sauveteurs hurlant dans des talkies-walkies), la cupidité des marchands et la multiplication des engins à moteur bruyants perturbaient la tranquillité des habitants des lieux ; ça le démoralisait. Moi aussi.
Je jurai de ne jamais quitter le bar de la plage tant qu’il y aurait Georges et des dry-martini ; ça laissa Gary songeur :
– Benett, je me demande comment tu fais pour boire un truc aussi bizarre, je veux dire si différent de la bière.
Il obtint de Georges qu’il approvisionnât le bar de la plage en bière et ils signèrent un pacte de non-agression concernant les goûts, les couleurs et les boissons de chacun.
On se remémora la séquence du film de Coppola « Apocalyspse Now » dans laquelle le lieutenant-colonel Bill liquide un village Viet pour que ses boys fassent du surf sur la plage. Colonel Bill adorait le surf et « l’odeur du napalm au petit matin », son vœu fut exaucé : l’aviation passa la forêt au napalm qui, par contre coup ou effet de souffle lissa les vagues. Ce cinglé de colonel Bill en était pour ses frais et le Vietnam pour une centaine de morts. Gary remît les choses en place :
– Benett, le surf est le sport le plus pacifique de la planète, ne te laisse pas prendre à ces conneries yankees.
Leslie céda à l’érotisme brûlant et inconfortable d’un minibus Volkswagen immatriculé à Sydney.
Un matin, de gros nuages plombaient l’horizon et l’océan avait rangé ses rouleaux ; Gary traînait comme une âme en peine :
– Benett, jure-moi que ce stupide idiot de colonel Bill n’est pas dans le coin !
J’aurais voulu le consoler en l’initiant aux bienfaits du dry-martini mais c’était trop tard, le minibus en provenance de Sydney était reparti à la recherche de nouvelles vagues.
Je crois qu’on s’est promis de s’écrire des cartes postales pour reparler de tout cela.
Episode 10
Tempête sous un crâne
Cela devait arriver, forcément : le bar de la plage est fermé. Trop de vent, trop de pluie, trop de vagues, trop de sable, trop de pessimisme : Georges le barman a rentré les chaises et les tables de la terrasse, ligaturé les parasols, arrimé les tabourets, et rabattu les grosses planches de bois qui verrouillent le bar et défendent les réserves de la cupidité des envahisseurs. Il a accroché une pancarte : « Fermé jusqu’à ce que je revienne ».
Je me suis assis à même le sable, le dos appuyé contre le bois rugueux du bar, les mains enfoncées au fond des poches de mon ciré. Les bourrasques en provenance du large s’acharnaient à vouloir m’arracher les cheveux.
Ce n’était pas tout à fait la fin du monde, seulement la mienne et d’une manière bien bizarre. Je me suis vu, cru, senti : immortel. Conséquence évidente : je n’allais pas mourir un jour, je n’allais plus mourir du tout. Je n’allais jamais disparaître ! Moi, Alexander Benett, fils d’une artiste peintre normande et d’un troisième ligne de rugby originaire d’Edimbourg et accessoirement diplomate au service de l’Angleterre, j’allais être le seul humain de la planète et peut-être de ses environs, à vivre éternellement. A voir tout ce qui se passerait sur terre au cours des milliards et des milliards d’années à venir, Et pourquoi pas assister à cette fameuse fin du monde pronostiquée par tous les savants ? Et alors, où est-ce que j’irai vivre, moi l’éternel, quand il n’y aura même plus de monde ? Tout cela était naturellement parfaitement inimaginable, et pourtant, je le sentais, je le vivais, j’en tremblais, tellement cette évidente énormité s’était emparé de tout mon être jusqu’au plus profond de mes cellules.
J’ai dû m’évanouir, de trouille…
La nature s’est peu à peu calmée. Georges m’a ressuscité en remettant le matériel en place, j’ai recommencé à respirer. Il a préparé un martini-dry, j’ai recommencé à boire. L’essentiel avait survécu : le bar de la plage était ouvert et je savais de nouveau que j’allais mourir un jour.
Episode 11
Les grands films commencent par la fin
On a revu la Dolce Vita. Dernières scènes : une bande de fêtards élégants, lunaires et solaires, envahissent la luxueuse maison d’un ami absent, pour y finir la soirée. Architecture modernissime épurée, intérieur blanc, escaliers blancs, murs-baies coulissants. Ils boivent, dansent, oublient et s’oublient. Une femme se déshabille. Au matin, le propriétaire de retour, les vire. Tout le monde est assez saoul, ils s’égayent à travers les arbres jusqu’au bord de la mer. Photographie en noir et blanc : l’élégance sombre des robes et des costumes s’imprime sur la pâleur du matin. Des pêcheurs ramènent dans leur filet un énorme poisson, sorte de monstre marin échoué sur le sable… Il y a l’embouchure d’une rivière. Sur la rive opposée, une fillette souriante et rieuse interpelle Marcello Mastroianni- Rubini – le journaliste people – langage des signes par-dessus le bruit des vagues. S’entendent-ils ? Une fille revient rechercher Marcello.… Il ne reste que la mer, le matin, l’horizon vide. Tout est dit. L’éternité et des vies qui passent ; celle laborieuse des pêcheurs, celle de la fillette qui commence avec son cortège d’espérance, celle des autres, oisives, brillantes et vaines, et puis la mort qui rode dans l’œil du poisson. Les lumières se rallument. On avait presque oublié la fontaine de Trevi et le décolleté d’Anita…
Fellini savait ce qu’il faisait, il nous a un peu baladés, On n’a pas fait très attention. L’essentiel était ailleurs, à la fin. Maintenant on est au courant, on va pouvoir revoir le film, pour de bon, sans impatience. C’est toujours un peu comme ça qu’il faut faire avec les grands films.
L’océan faisait semblant de nous écouter, le vent ne voulait pas nous déranger. Les oiseaux de mer avaient leur compte, ils avaient déserté la scène.
On est resté encore un bon moment avec Marcello et ses belles amies…


