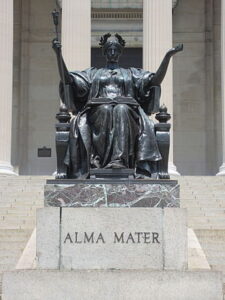 Qu’une revue de réflexion comme Esprit se penche une nouvelle fois sur cette question n’est pas superflu, tant les maux de notre université sont palpables. Ce numéro en liste quelques-uns, les enseignants précaires, de plus en plus nombreux, les aléas voire les mirages de l’autonomie, les défaillances de l’administration, l’allocation des fonds pour la recherche compliquée et pas toujours bien orientée. Ces problèmes-là ne sont pas si graves. Car il y a déjà eu des vagues de titularisation des précaires ; l’autonomie peut être davantage encadrée ou renforcée, une fois précisé ce en quoi elle pèche aujourd’hui ; la prise de décisions n’est pas si mauvaise, compte tenu que les présidents et directeurs d’UFR sont soumis au bon vouloir de leurs électeurs. Quant à la recherche, si les procédures doivent être simplifiées, il est inévitable que l’arbitrage entre les nécessités de l’économie qui poussent à orienter les crédits dans certaines directions et la non moins nécessaire liberté de la recherche laisse certains chercheurs insatisfaits.
Qu’une revue de réflexion comme Esprit se penche une nouvelle fois sur cette question n’est pas superflu, tant les maux de notre université sont palpables. Ce numéro en liste quelques-uns, les enseignants précaires, de plus en plus nombreux, les aléas voire les mirages de l’autonomie, les défaillances de l’administration, l’allocation des fonds pour la recherche compliquée et pas toujours bien orientée. Ces problèmes-là ne sont pas si graves. Car il y a déjà eu des vagues de titularisation des précaires ; l’autonomie peut être davantage encadrée ou renforcée, une fois précisé ce en quoi elle pèche aujourd’hui ; la prise de décisions n’est pas si mauvaise, compte tenu que les présidents et directeurs d’UFR sont soumis au bon vouloir de leurs électeurs. Quant à la recherche, si les procédures doivent être simplifiées, il est inévitable que l’arbitrage entre les nécessités de l’économie qui poussent à orienter les crédits dans certaines directions et la non moins nécessaire liberté de la recherche laisse certains chercheurs insatisfaits.
Un article donne quelques données factuelles. Ainsi un tableau met-il en rapport les budgets par étudiant des établissements dépendant du MESR avec le nombre de leurs étudiants. Il montre deux choses : d’abord, sans surprise, que les établissements les mieux dotés à cet égard (des grandes écoles) sont ceux qui ont le moins d’étudiants. Pour les universités, la courbe est remarquablement plate, les dotations par étudiants sont peu dispersées et indépendantes du nombre d’étudiants comme du label de qualité (IDEX, I-SITE) dont certaines bénéficient. Question financement, toujours, la part allouée par le Ministère au titre des subventions pour charge du service public diminue (73 % en 2022 contre 87 % en 2014) avec une augmentation corrélative des ressources « propres » (ANR, régions) affectées (à un projet de recherche, la construction d’un bâtiment, etc.). On apprend également que la réforme ORE n’a pas entraîné l’effet d’éviction redouté par certains. Au contraire, le taux de poursuite d’études post-bac a augmenté en même temps que le nombre de bacheliers (de 74 % en 2018 à 78 % en 2021). Avec une forte croissance des effectifs étudiants dans le privé (+ 60 % entre 2010 et 2021), principalement dans les écoles de management et les BTS. Publique ou privée, la massification de l’enseignement supérieur se poursuit.
Un bien ou un mal ? La question n’est pas directement posée. Par contre l’un des participants à un débat organisé par la revue, intitulé « L’université comme idéal », affirme sans être contredit par quiconque qu’il faudrait « renoncer à la sélection pour donner le droit à l’erreur et à la réorientation ». Parler de sélection à propos de Parcoursup est à la fois vrai et faux : vrai parce que les universités sont en partie libres de choisir leurs étudiants mais en partie seulement puisque, au final, chacun doit se voir affecter une place en 1ère année de licence. Globalement, l’université n’est donc pas sélective dans ce pays. Un bien ou un mal ? Au vu des résultats, il est quand même surprenant que la question ne soit jamais posée dans un numéro intitulé « Quelle université voulons-nous ? ». Veut-on vraiment continuer avec un système où seulement un tiers des étudiants de licence obtiennent leur diplôme en trois ans et moins de la moitié en 3 ou 4 ans ? Et encore n’est-ce là qu’une moyenne : dans les universités les moins performantes ces chiffres s’étagent entre 20 et 14 % (3 ans), 32 et 19 % (4 ans). Il s’agit, sans surprise, par résultats décroissants pour la licence en 3-4 ans, de Paris 8, Paris 13, la Réunion, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, Mayotte et la Guyane.
Ces chiffres qui signent un échec particulièrement douloureux de l’enseignement obligatoire dans ces territoires plus ou moins perdus de la République ne sont que la triste caricature d’un état général de nos universités. Esprit insiste sur le malaise des enseignants, la précarité de certains, la surcharge de travail liée aux tâches administratives, les rémunérations insuffisantes. Soit, au moins pour beaucoup de ces maux, mais le malaise principal est bien plus profond, il est celui de se trouver dans la plupart des filières de licence – pas uniquement an première année – face à des étudiants pour la plupart démobilisés parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas à leur place et que leurs chances de réussite sont quasi-nulles. Le niveau de l’enseignement se dégrade alors fatalement et les enseignants eux-mêmes finissent par se démobiliser. Des heures de cours sont raccourcies ou sautent carrément, il y a de moins en moins de corrections, les examens se simplifient avec une tendance à la généralisation des QCM dans certaines disciplines ou l’invention des « oraux écrits » (des examens d’une durée d’une heure ou moins pendant laquelle les étudiants doivent répondre à une ou deux ou trois questions, réponse qui pour beaucoup se résumera à quelques lignes). L’aquoibonisme devient la philosophie de nombre d’enseignants : pourquoi se démener pour des étudiants qui soit s’en fichent, soit sont incapables de comprendre ? Et si en plus ces enseignants s’estiment mal payés…
On souligne dans ce dossier d’Esprit l’insuffisance du montant des bourses, les difficultés rencontrées par des étudiants obligés de trouver un travail à côté. Certes, mais il n’est nulle part fait mention des étudiants décrocheurs qui s’inscrivent uniquement pour la bourse, laquelle, aussi faible soit-elle, est toujours bonne à prendre. Quand on regarde le taux d’encadrement des étudiants par les enseignants (en décroissance globale), il faut aussi tenir compte de tous ces étudiants fantômes. Un cinquième des étudiants (dont les deux tiers viennent de l’université) quittent l’enseignement supérieur sans diplôme, à l’université spécifiquement un quart des étudiants en première année de licence ne l’achèvent pas.
Pour revenir aux enseignants, il est justement fait mention de la situation des non-titulaires, souvent encore étudiants en thèse ou qui viennent de la terminer et espèrent une titularisation, et qui constituent une main d’œuvre corvéable à merci, ce dont certaines titulaires ne se privent pas. Les contributions de ce numéro s’intéressent peu à ces derniers, sinon pour remarquer qu’ils sont sous-payés par rapport à leurs diplômes, ce qui explique que certains aillent chercher des compléments de rémunération ailleurs. Sous-payés ? Ça dépend en réalité de ce qu’ils donnent en échange de leur traitement. Il est certain que les enseignants, professeurs ou maîtres de conférences, qui dirigent un centre de recherche, une UFR (sans parler d’une université) ou une filière et parviennent, tout en donnant sérieusement quelques cours, à produire bon an mal an un travail de recherche de bon niveau, ceux-là donnent largement en retour du traitement accordé par l’État.
On n’en dira pas autant de l’enseignant-chercheur de haute volée qui passe la moitié de son temps dans des universités à l’étranger où il se fait rémunérer pour ses services et qui s’arrange pour en faire le moins possible dans son université en France (une astuce parmi d’autres consiste à regrouper deux masters différents dans un seul auditoire et à compter double le nombre d’heures de cours dans le service de l’enseignant en question). Idem pour ceux qui ayant opté pour le privé (avocat, conseil en tout genre, enseignement dans des établissements privés) ont abandonné de facto toute ambition en matière de recherche, tout en conservant leur poste à l’université : quand la rémunération accessoire dépasse la rémunération principale, le métier principal devient fatalement l’accessoire ! Une catégorie voisine est celle du quasi-rentier qui se satisfait de son traitement mais a l’essentiel de sa vie ailleurs, parfois dans des engagements associatifs, plus souvent dans des activités purement familiales ou de loisir égoïste. À cet égard, le participant à un autre débat intitulé « Un modèle d’université publique ? » remarque fort justement – mais sans y voir à mal, apparemment – que les universitaires savent parfaitement se défendre lorsque le gouvernement tente de remettre en cause certaines pratiques tenant du privilège : le décret de 1997 instaurant l’évaluation des enseignements n’est pas appliqué, pas plus que l’arrêté pris en 2009 qui dispose que les enseignants-chercheurs ne faisant en réalité pas de recherche enseigneront davantage. Si ce dernier l’était, le problème de l’insuffisance du nombre des enseignants serait moins aigu. On pourrait s’étonner que les enseignants des universités refusent de telles mesures de bon sens et de surcroît conformes à une éthique élémentaire. Ce n’est hélas pas nouveau, Adam Smith, dans la Richesse des nations (1776) dénonçait déjà les ravages de l’esprit de corps chez les universitaires !
Ajoutons que la question de la rémunération a partie liée avec la massification de l’enseignement supérieur et la multiplication des enseignants. Le professeur d’antan qui faisait son cours en toge et pénétrait dans l’amphithéâtre précédé d’un appariteur en habit d’huissier était un notable. Il était d’ailleurs issu de la bourgeoisie et jouissait le plus souvent des revenus de son capital ou de celui de son épouse oisive. Aujourd’hui, le professeur d’université, dépouillé de tous les appareils de sa fonction, vêtu à peu de chose près comme ses étudiants, dont le conjoint travaille, se fond dans la cohorte de plus en plus nombreuse de ses pairs.
L’année universitaire est très courte : les cours sont concentrés sur deux « semestres » de 12 semaines chacun. Un enseignant-chercheur doit 128 heures de cours par an (192 heures de travaux dirigés). C’est dire qu’il est tout à fait possible de remplir sérieusement son métier d’enseignant et – à moins d’être investi à fond dans des responsabilités administratives – de satisfaire sa passion qui est plus souvent celle de la recherche, mais à son rythme. La liberté des universitaires est réelle et c’est la raison pour laquelle il y a encore tant de docteurs qui aspirent à être intégrés dans le corps. Comme le souligne un intervenant, le modèle ultracompétitif des universités américaines (jusqu’à l’obtention de la tenure) ne convient pas à tous.
L’un des charmes de la profession d’enseignant-chercheur est la liberté qui l’accompagne, liberté de recherche et, comme le prévoit explicitement le statut, liberté d’expression « dans le respect des principes de tolérance et d’objectivité ». Or l’université est agitée en ce moment par une querelle entre woke et anti-woke qui s’accusent mutuellement d’intolérance et d’absence d’objectivité. Ce n’était certes pas le lieu dans ce numéro de trancher sur la validité des thèses en présence : ceci réclamerait un examen approfondi des travaux de recherche des uns et des autres. Il est néanmoins surprenant que cette dispute et les incidents qu’elle a provoqués ne soient évoqués nulle part, comme si l’université n’était qu’un temple du savoir où l’on s’emploie paisiblement à l’augmentation des connaissances.
Un dernier mot sur l’environnement, loin d’être aussi vétuste qu’il est écrit. De nombreux bâtiments modernes ont été construits et certaines campus n’ont plus grand-chose à envier avec ce qui se fait de mieux à l’étranger. Par ailleurs, un programme de rénovation énergétique de l’existant est en cours. Ce que l’on pourrait déplorer c’est que ce bâti soit aussi peu utilisé, vu la brièveté de l’année universitaire.
« Quelle université voulons-nous ? », Esprit n° 499-500, juillet-août 2023, 208 p., 22 €.

