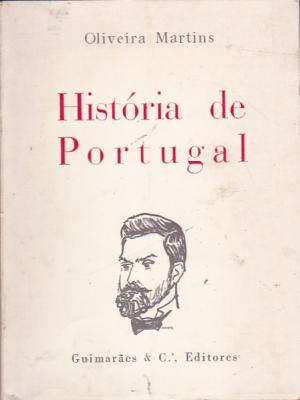Ses procès enfreignaient les règles élémentaires de la justice et du bon sens. Les délateurs servaient de témoins ; les enfants déposaient contre leurs parents, et les parents contre leurs enfants ; l’accusé ne pouvait pas communiquer avec ses défenseurs, et ne savait pas qui l’accusait ; la délation était applaudie et l’espionnage considéré comme une vertu. Les familiers s’insinuaient dans les familles, au titre de médecins, confesseurs, intimes et conseillers, pour capter les secrets et les livrer. La sentence n’était susceptible ni de révision ni d’appel. Dans les prisons, il n’y avait pas de détention préventive, et l’incarcéré gisait durant des mois, des années, tout le reste de sa vie souvent, dans l’ignorance du crime dont on l’accusait. On montait des pièges et des perfidies pour le perdre. On mettait en prison des individus subornés, qui se disaient aussi condamnés, pour l’amadouer et compatir à sa misère. Sa confiance étant ainsi gagnée, venaient les confidences : l’Inquisition était une horreur, une plaie ! Si le malheureux, perdu, applaudissait à ces propos, il était condamné. Pour obtenir l’aveu de ses fautes, souvent imaginaires, les inquisiteurs feignaient de s’attendrir, promettaient le pardon, sollicitaient, séduisaient, jusqu’à ce que le malheureux confessât ce qu’il avait fait, ou pas fait.
Cette sorte de torture était le plus souvent plus douloureuse que l’autre ; les malheureux emprisonnés en venaient à considérer comme un paradis le noir cachot où ils ne pouvaient ni voir, ni parler, ni gémir, ni pleurer, sous peine du fouet du bourreau. Au cœur des ténèbres et du silence absolu, ils ne savaient plus bien s’ils vivaient encore ou étaient déjà morts et, comme des idiots, se couchaient sur le sol, immobiles dans l’antre sépulcral.
Chaque fois que la porte du cachot s’ouvrait, ils tremblaient de peur, ou d’une espérance pas encore éteinte. On les emmenait enchaînés à la chambre de torture ; et tandis qu’ils descendaient les escaliers tortueux où les cris se perdaient, étouffés, leur esprit s’enflammait, leurs idées s’emmêlaient, ils ne distinguaient plus le réel du supposé ; ils commençaient à se prendre pour des monstres, à croire tout ce dont ils étaient accusés : ils avaient vu le diable en personne, lui avaient vendu leur âme, avaient brisé un crucifix à coups de hache, etc. Funèbre et froid, assis au fond de la cave voûtée, mal éclairée par des torches que tenaient aux murs des anneaux de fer, l’inquisiteur croyait-il au diable et à ses apparitions ? Pourquoi pas ? C’était un dément torturant un idiot ; et, dans les profondeurs obscures d’une crypte, la folie des hommes faisait de terribles agapes.
Ils avaient l’air de démons, les bourreaux, muets et masqués, en simarre de hollande noire et cagoule trouée à l’endroit des yeux et de la bouche, se mouvant comme des automates pour la préparation des instruments de torture ; et de tous ces gens, le médecin lui-même, présent pour veiller à ce que la vie des patients ne s’éteignît pas tout-à-fait, n’était pas sain d’esprit. Depuis que les hommes se jugeaient maîtres de la vérité absolue, la parole de Dieu les rendait fous, et faisait d’eux des monstres. Dans ces lugubres tragédies le malheureux mourait parfois, sous la torture ou en prison ; et il était alors enterré dans les basses-fosses du palais, après qu’on eut dépecé son squelette, religieusement, pour que ses os pussent figurer dans le prochain auto da fé, et brûler sur le bûcher.
Le premier de ces drames funèbres et burlesques eut lieu à Lisbonne le 20 septembre 1540 : l’Inquisition n’était pas encore définitivement confirmée par le pape.
La procession sortit du palais du Rossio, vers la Praça da Ribeira, où avait lieu la cérémonie. Devant marchaient les charbonniers, armés de piques et de mousquets, qui avaient la charge des bûchers ; puis une croix dressée, et les frères de Saint Dominique, dans leurs habits et scapulaires blancs avec une croix noire, portant l’étendard de l’Inquisition où, sur un tissu de soie on voyait la figure du saint, tenant d’une main l’épée vengeresse, de l’autre un rameau d’olivier : Justitia et Misericordia. Derrière les frères, venaient les personnes de qualité, à pied : les familiers de l’Inquisition, vêtus de blanc et noir, avec des croix des deux couleurs, soulignées de fils d’or.
Puis venaient les condamnés, un par un, en file ; d’abord les morts puis les vivants, par catégorie de délits : fictos, confictos, falsos et simulados (simulateurs divers), confitentes (avoués), diminutos (réconciliés), impenitentes (impénitents), negativos (endurcis), pertinazes (obstinés) et relaps ; en allant des morts aux contumaces.
Au bout de piques tenues comme des hampes, que portaient les hommes en simarre et cagoule de hollande noire, pendaient les effigies des condamnés absents, vêtues de la carocha et du san-benito ; si l’effigie représentait un mort, un autre bourreau marchait derrière elle porteur d’une boîte noire peinte de démons et de flammes, contenant les os qui seraient jetés aux pieds de l’effigie dans le bûcher. Plus d’une fois on brûla les squelettes déterrés de personnes qui, sauves de leur vivant, furent jugées et condamnées après leur mort.
Ensuite venaient les condamnés en vie, par ordre croissant de la gravité de leurs crimes, sans distinction de sexe, l’un derrière l’autre, flanqués de leurs parrains ou d’un confesseur dominicain s’ils allaient être brûlés. Les hommes étaient vêtus d’une tunique rayée de blanc et noir, et allaient les mains, la tête et les pieds nus ; les femmes portaient de longs vêtements du même tissu. Tous avaient à la main des cierges de cire jaune et la corde au cou. Des insignes particuliers distinguaient des pénitents et des confesseurs ceux qui allaient aux flammes. Ceux qui portaient le san-benito, sorte de tunique blanche, marquée de la croix de Saint-André en rouge, sur la poitrine et dans le dos ; et ils allaient tête nue. Ceux qui après la sentence avaient été graciés du bûcher portaient la simarre, une tunique brune ; et la carocha, une mitre en carton ; sur l’une et l’autre étaient peintes des langues de feu renversées, le fogo revolto, indiquant leur sort. Les condamnés à mort, qu’ils dussent être étranglés d’abord ou pas, ceux qui morts ou vifs, étaient destinés aux flammes, portaient, peint sur la simarre et la mitre, leur portrait cerné de noirs démons au milieu des flammes, portant inscription de leur nom et du crime pour lequel ils allaient être suppliciés.
En queue de la longue procession, venaient les hallebardiers de l’Inquisition et, à cheval, les officiers du conseil suprême, inquisiteurs, qualificateurs, rapporteurs, et autres sectateurs de la cour inquisitoriale. Les cloches des églises tintaient lentement. La foule se pressait dans les rues, insultant les condamnés avec des mots orduriers, leur jetant des pierres et de la boue.
Des cordons de troupes empêchaient le peuple d’envahir la place, l’espace réservé à l’auto da fé. Il y avait là, d’un côté, à l’écart, les tas de bois, rectangulaires, avec un poteau dressé au milieu et un banc ; et au centre de la place un espace réservé pour l’estrade et les tribunes. Dans celle de gauche se trouvait le roi Dom João III, pieusement satisfait dans sa foi, en esprit dur, mais sincère et fort qu’il était ; il y avait la reine et la cour ; et à côté du monarque, le connétable, l’épée hors du fourreau. Dans l’autre tribune, celle de droite, se dressaient le trône et le dais du cardinal Dom Henrique, plus tard roi, et à présent infant Grand Inquisiteur, entouré des membres du tribunal sacré, sur leurs bancs.
Au milieu de l’estrade se dressait l’autel, recouvert d’une nappe noire, portant des chandeliers chargés de cierges de cire jaune, avec un crucifix au centre. En face, sur un socle, se trouvait l’étendard de l’Inquisition. D’un côté la chaire ; de l’autre la table des rapporteurs de sentences, couverte de registres barrés de sceaux ; les condamnés, en rang, se tenaient debout, devant l’autel, la chaire et le tribunal.
On dit la messe. Le grand Inquisiteur, en cape et mitre, présenta au roi les Evangiles, pour qu’il jurât sur elles de défendre la foi. Dom João III et tous les autres, debout et découverts, jurèrent avec une solennelle sincérité. Puis il y eut le sermon général ; et finalement la lecture des sentences, en commençant par les crimes véniels.
L’adoration des images, question débattue dans les conciles, donnait lieu à maintes condamnations. Certains étaient là pour avoir refusé de baiser les images de saints, sur les troncs avec lesquels les frères allaient par les rues en demandant l’aumône. D’autres pour irrévérence, manquements aux principes canoniques ; beaucoup pour rien du tout, la plupart étant victimes de délations perfides et intéressées. Les rapporteurs lisaient les sentences, les condamnés gémissaient parfois, et pleuraient ; d’autres exultaient de se voir libres de la prison, libres de la torture, et se promettaient à eux-mêmes d’être à l’avenir méticuleusement hypocrites.
On en vint finalement aux condamnés à mort, au bûcher : il s’agissait de trois femmes, pour faits de sorcellerie, et deux hommes, Nouveaux Chrétiens, pour avoir judaïsé, un quatrième pour cause d’envoûtements.
Le rapporteur, imperturbable, lut les sentences où l’on décrivait les crimes. Les Nouveaux Chrétiens mangeaient du pain azyme ; et l’un d’eux, lorsqu’il balayait sa maison, insultait un crucifix, lui faisait des grimaces et le griffait autant de fois qu’il donnait de coups de balai. Ces crimes étaient enveloppés de mots horribles et d’effrayantes généralités ; et la cour, le clergé et le peuple, à l’audition de tels sacrilèges, bouillaient de haine contre les malheureux.
La sorcière ne les impressionnait pas moins. Nouveaux Chrétiens et sorciers, jeteurs de maléfices et de mauvais œil, étaient la cause des pestes, famines et naufrages des nefs de l’Inde. Sur la tête des malheureux tombaient les malédictions d’une population affligée. Personne ne doutait de la véracité des crimes, que maints témoins attestaient. Le diable étant apparu à l’un d’eux, et lui avait appris des médecines infernales, selon la requête de São Cipriano. Il saignait les malades par le front, en y plantant des aiguilles. « On m’a piqué et envoûté : par Jésus ! Au nom de Jésus ! Dépiquez-moi et désenvoûtez-moi ! » – avait crié une victime, en suppliant un curé de la Beira. Les démons, pour se venger, avaient envahi la maison du prêtre et brisé sa vaisselle. Un cas terrible celui-là ; et le peuple regardait avec horreur le médecin de São Cipriano, qui portait la folie sur son visage. Aux sorcières le diable apparaissait sous la forme d’un chat noir, et la nuit sous la forme humaine d’un petit homme : c’est ce que disait gravement la sentence, après examen des témoignages. La sorcière sortait avec le démon, et ils allaient ensemble à la rivière, où ils retrouvaient d’autres sorcières et d’autres démons ; après s’être baignés, ils copulaient en des poses lascives et abominables : la sentence les énumérait ; la débauche de la cour et du peuple les comprenait et les commentait. Au retour du sabbat, à l’aube, les sorcières invisibles entraient dans les maisons, et persécutaient les familles honnêtes et pieuses.
Une fois la lecture terminée et les pénitents absous, Nouveaux Chrétiens et sorcières furent livrés au bras séculier, pour être brûlés. Le roi, la cour, l’inquisiteur, se retirèrent ; les cloches continuèrent à sonner, lentement et sinistrement…
Les charbonniers à hallebardes, les bourreaux en cagoule, les frères en scapulaire et le crucifix à la main, restèrent près des condamnés pour les brûler. Le peuple se pressa autour de l’endroit où se dressaient les bûchers rectangulaires, les yeux avides, la tête bouillant de colère contre les responsables de ses malheurs. Tous, sauf l’envoûteur, moururent pieusement garrotés, puis brûlés.
Le médecin de São Cipriano, cependant, était coupable de fautes majeures et on l’avait condamné à être brûlé vif. Près du bûcher, le frère, les mains jointes, lui demandait, pour l’amour de Dieu, de se repentir ; mais lui, fou, les yeux hagards, secouait la tête et se moquait. Gravissant en courant les marches, il monta au bûcher et de là-haut, assis sur le banc, se mit à faire des grimaces et mimiques irrévérentes. Le frère battait sa coulpe, la plèbe rugissait de colère. Les bourreaux l’attachèrent au poteau, les charbonniers allumèrent le bûcher, qui commença à crépiter. Garçons et filles de la Ribeira, en l’assaillant à coups de piques et de crochets, lui arrachèrent un œil. On lui jetait des pierres, des clous, n’importe quoi, et lui faisait des blessures d’où coulait le sang : il avait le front ouvert et la lèvre arrachée. Pendant ce temps, les flammes commencèrent à monter entre les bûches ; et lui, en se tordant, tapait sur le feu, pour l’éteindre ; quand il voyait, de l’œil qui lui restait, arriver une pierre, il se faisait un bouclier de sa simarre, pour l’éviter. Du vide de l’autre orbite coulait sur son visage un filet de sang. Ceci durait déjà depuis plus d’une heure et amusait beaucoup le peuple – qui avait maintenant la certitude de voir mourir son ennemi. Mais le vent, qui soufflait fortement de l’Ouest, des berges du Tage, couchait les flammes ; et faute d’être suffoqué par la fumée, le condamné resta vivant durant trois heures, agonisant, à griller en se tordant, et grimacer en hurlant – Ai !… Ai !… Ai !…
Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894), extrait de son Histoire du Portugal, 1879, traduction de Claire Cayron